Dernière mise à jour 28 janvier
Les derniers ajouts sont indiqués ainsi dans la page : Dernier ajout.


Mise en ligne 15 octobre
La Série Noire au Cinéma - 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches
Du samedi 6 septembre 2025 au samedi 14 février 2026
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)
48 rue Cardinal Lemoine, Paris 5e
La Bibliothèque des Littératures Policières reprend l' exposition, La Série Noire au cinéma. 80 ans d'écrans noirs et de nuits blanches, présentée à la galerie Gallimard à l'occasion des 80 ans de la collection Série Noire et fête ses 30 ans d'installation au 48-50 rue du Cardinal Lemoine en tant que bibliothèque patrimoniale et spécialisée.
Sous l’impulsion du traducteur Marcel Duhamel, ami de Jacques Prévert et de Raymond Queneau, les Éditions Gallimard lancent en août 1945 une toute nouvelle collection, la « Série noire », consacrée aux œuvres les plus représentatives du nouveau roman policier anglais et américain. Le succès rencontré par cette littérature de genre réinventée, à laquelle la NRF apporte son crédit littéraire, est indissociable de la vogue du film noir américain dans les salles françaises de l’après-guerre.
80 ans, 3000 polars et quelque 500 films plus tard, la « Série noire » reste plus que jamais attachée à cette double appartenance où son mythe s’est forgé.


Dernier ajout
Mise en ligne 28 janvier
Date de début : 11 septembre 2025 - Date de fin : 21 mars 2026
Sous la surface, les maths
Institut Henri Poincaré -Adresse: Sorbonne Université / CNRS 11 rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05
Comment représenter en 2D un objet en 3D ? Comment créer des personnages et décors de jeux vidéo convaincants ? Quel est le lien entre la couture, la géographie et l’infographisme ?
Grâce à l’exposition Sous la surface, les maths, découvrez les principes mathématiques cachés derrière ces questions !
À travers des jeux, des vidéos explicatives, des objets de mesure, mais aussi des modèles mathématiques des collections de l’Institut Henri Poincaré, vous deviendrez incollable sur la création de surfaces numériques.
La première partie de l’exposition s’intéresse à la représentation des objets en 3D sur un plan en 2D, problème que se posaient déjà les peintres de la Renaissance. Le voyage se poursuit ensuite, non pas au centre de la Terre, mais à sa surface. Comment passe-t-on du globe au planisphère ? Enfin, tous les secrets de fabrication qui rendent les jeux vidéo si réels et vivants vous seront dévoilés : de la goutte d’eau à la texture de la peau, en passant par le rendu lumineux.
Fractales, surfaces réglées, paraboloïdes hyperboliques, ce voyage au pays de la géométrie et de la topologie va vous surprendre et vous faire comprendre que sous la surface, se cachent bien plus de maths que vous ne le pensez.
Exposition conçue par l’Institut Henri Poincaré́ et le Musée des Arts et Métiers, avec le soutien du Fonds de dotation de l’IHP.
À télécharger Dossier présentation expo SLSLM

Mise en ligne 21 janvier
Robert Doisneau, Gentilly
19 Sept 2025 au 15 Fév 2026 13h30-19h00
Maison de la Photographie Robert Doisneau
Adresse : 1 rue Division du Général Leclerc, Gentilly
L’histoire des photographies de Robert Doisneau à Gentilly s’ouvre dans cette ville de banlieue parisienne qui l’a vu naître et s’y referme soixante ans plus tard. Doisneau a souvent été qualifié de « photographe de banlieue » ou « d’amoureux de la banlieue », des étiquettes réductrices qui simplifient son rapport complexe à ce territoire et à Gentilly en particulier. Il serait plus exact de parler ici d'un ancrage biographique, affectif et artistique, alliant familiarité et distance critique.
De ses premières images, datant des années 1940, à ses derniers clichés pris dans les années 1980, il documente l’évolution profonde de cette commune populaire de la périphérie. En 1992, un livre et un projet d’exposition sont envisagés, mais il décède en 1994 avant leur concrétisation. La présente exposition ainsi que le catalogue qui l’accompagne rendent hommage à ce projet inachevé, à l’exploration de cette ville qui fut à la fois origine, matière et miroir pour le photographe.
Dossier de presse Robert Doisneau


Mise en ligne 9 janvier
Sarah Lipska (1882-1973), sculptrice, peintre, styliste et décoratrice
Du 19 septembre 2025 au 22 février 2026
Le Musée d’art et d’histoire de la Ville de Meudon et le Musée Sainte-Croix de Poitiers s’associent en 2025-2026 dans un projet commun de valorisation du travail de l’artiste d’origine polonaise Sarah Lipska (Mława, 1882 – Paris, 1973).
Monté en collaboration avec la spécialiste de l’artiste, Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie, et soutenu par l’Institut polonais de Paris, ce projet d’exposition sera mené en deux étapes entre l’automne 2025 et l’été 2026.
Sculptrice, peintre, dessinatrice de costumes et de décors, créatrice de mode et décoratrice d’intérieur, Sarah Lipska est une artiste fascinante dont le travail n’a jamais fait l’objet d’une rétrospective en France. Malgré de nombreuses récompenses et une reconnaissance certaine de son vivant, elle est aujourd’hui et à l’instar de nombreuses créatrices relativement méconnue.
D’origine polonaise, Sarah Lipska naît dans une famille juive bourgeoise de Mława, en Pologne. Elle étudie à l’École des beaux-arts de Varsovie, où elle se forme aux arts appliqués ainsi qu’à la sculpture dans l’atelier du célèbre Xavier Dunikowski (1875-1964). Quittant son pays natal en 1906, elle s’installe à Paris en 1912. Dans ces années-là, elle collabore avec les Ballets russes et plus particulièrement avec Léon Bakst (1866-1924), célèbre décorateur et costumier de la compagnie de Serge Diaghilev (1872-1929), dont les productions inspirent durablement l’œuvre de Lipska.
Après sa collaboration avec les Ballets russes, elle travaille pour le monde du théâtre parisien et conçoit notamment en 1922 les costumes de l’opérette Annabella, dont les critiques soulignent la réussite. À l’instar de ses peintures et vêtements, ses créations destinées à la scène sont très colorées – ce sera également le cas des projets de costume pour le Ballet des oiseaux, auquel elle travaille avec le chorégraphe et danseur ukrainien Serge Lifar (1905-1986) après la Seconde Guerre mondiale.
Cette grande attention à la lumière et aux matières se retrouve dans son travail de créatrice de mode. Après une collaboration avec le grand couturier Paul Poiret (1879-1944) puis avec la maison de couture Myrbor dans les années 1920, Sarah Lipska ouvre son propre atelier à Montparnasse, sans doute dès 1925. Reproduites dans plusieurs numéros de Vogue des années 1925-1927, ses créations textiles mêlent influences des arts populaires d’Europe centrale, vocabulaire graphique très coloré et matières soigneusement choisies telles que la mousseline de coton ou le fil métallique. Sans doute en raison de son succès, elle déménage en 1928 son atelier situé avenue des Champs-Élysées où elle reçoit notamment sa compatriote, l’entrepreneuse Helena Rubinstein (1872-1965), mais également la comédienne Cécile Sorel (1873-1966), la cantatrice Ganna Walska (1887-1984) ou encore la princesse russe Natalie Paley (1905-1981). Elle habille également le coiffeur-star Antoine Cierplikowski (1884-1976), avec qui elle entretient une longue relation amicale et professionnelle. Pour l’extravagant Antoine de Paris, elle conçoit costumes de bal et tenues sportives.
Là où les productions picturales et textiles de l’artiste sont tout en opulence et couleurs, son travail de décoratrice d’intérieur s’inscrit dans un fonctionnalisme élégant et épuré. Première démonstration de ses talents est faite dans la célèbre publication Le Style moderne. Contribution de la France publié en 1925 avec une introduction d’Henry van de Velde qui prône « une forme pure et rationnelle ». Reproduits aux côtés des créations de Robert Delaunay (1885-1941), Le Corbusier (1887-1965) ou Robert Mallet-Stevens (1886-1945), les intérieurs de Lipska sont extrêmement épurés, à l’instar du coffre en bois et métal conservé à Poitiers.
Dans la seconde moitié des années 1920, elle travaille à plusieurs projets de décoration d’intérieur, dont deux pour Antoine de Paris entre 1925 et 1935. Pour le premier, la célèbre maison de verre du 4 rue Saint-Didier, elle fait partie des précurseurs de l’utilisation du verre industriel épais dans l’aménagement d’intérieur, faisant preuve d’une audace avant-gardiste remarquée par la critique.
Cette audace se retrouve également dans sa pratique sculpturale, à laquelle elle s’est formée à Varsovie avec Xavier Dunikowski. Les portraits de personnalités et de proches scandent l’intégralité de sa carrière : Xavier Dunikowski, Antoine de Paris, Arthur Rubinstein (1887-1982), Natalie Paley sont les sujets de portraits synthétiques aux matériaux et textures soigneusement choisis : pierre artificielle pailletée, résine rouge porcelaine, bois et verre.
Aux côtés des portraits, les figures d’oiseaux peuplent la production sculpturale de Lipska. Dès ses premières peintures, la légèreté des oiseaux, leurs plumes, leurs formes font échos à son travail sur les ballets. Oiseaux en verre, en plâtre, en ciment, en miroir, ils forment un bestiaire coloré qui se retrouve également dans son travail de couturière, de costumière et de peintre. Dans les années 1920, puis 1940, les natures mortes et oiseaux font l’objet de grands formats colorés qui puisent parfois leur sujet dans l’Ancien Testament.
L’exposition
L’exposition présente près de 90 œuvres (sculptures, dessins, peintures, mobilier…) et vous permet découvrir :
- La formation de l’artiste et le rôle de Xawery Dunikowski, sculpteur talentueux et père de sa fille. Des portraits croisés des deux artistes montrent leur complicité artistique dans le temps.
- Sarah Lispka à son arrivée en France : à partir de 1912, focus sur son travail de costumière et décoratrice pour des ballets à travers un ensemble de dessins mais aussi de peintures, œuvres indépendantes où s’expriment ses motifs familiers.
- 1925 et l’Exposition internationale des arts décoratifs. Sarah Lipska y obtient une médaille pour un coffre en métal, elle présente également des tapisseries. Des esquisses originales et des photographies d’époque entourent le mobilier présenté.
- Les portraits sculptés et peints des années 1930 : En ciment, résine, plâtre, pierre artificielle, verre ou huiles sur toiles ; les portraits de personnalités du milieu parisien dominent et dessinent le réseau artistique de Sarah Lipska : Helena Rubinstein, Nathalie Paley, Sofia Piramowicz, Antoine de Paris…
- La mode : cette partie sera seulement évoquée par des esquisses et dessins. Nous vous invitons à l’exposition de Poitiers pour découvrir les vêtements et tissus orignaux. Sarah Lipska dessine pour la maison Myrbor et Paul Poiret puis ouvre en 1924 sa propre maison de couture.
- Ses collaborations avec Antoine, coiffeur et entrepreneur, célébrité du Tout-Paris mondain: elle réalise son portrait, mais également l’aménagement de ses appartements et des projets graphiques.
- L’oiseau : La fascination continue de Lipska pour la figure de l’oiseau, depuis les œuvres picturales des années 1920 et 1940 jusqu’aux productions sculpturales de la fin de sa vie, en passant par le Ballet des oiseaux qu’elle conçoit après-guerre et les productions graphiques pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
D’importantes campagnes de restauration


Mise en ligne 4 octobre
Exposition
"Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection."
19 septembre 2025 au 22 mars 2026
D’où vient le fonds inestimable du Domaine de Sceaux ? L’exposition retrace cette aventure patrimoniale depuis l’ouverture du musée d’Île-de-France, en 1937. Au fil du temps et des acquisitions, les collections se sont recentrées sur les grandes figures qui ont marqué l’histoire du Domaine.
Les 150 œuvres présentées témoignent de l’identité singulière du Château de Sceaux. Pour l’occasion, certaines pièces rares, tenues en réserves pour leur fragilité, sortent de leur réserve pour la première fois. Vous découvrez par exemple le spectaculaire transparent des Quatre Saisons de Carmontelle, de 42 mètres de long, ou encore des objets insolites, comme une fontaine à coco du XIXe siècle, des porcelaines de la manufacture de Sceaux, et une sélection d’ouvrages et de textiles.
Au-delà des œuvres, un parcours immersif invite le visiteur à découvrir les coulisses du musée. Comment gère-t-on les collections ? À quelles expertises fait-on appel pour assurer leur conservation, les documenter et les transmettre ? Un parcours invite le visiteur à explorer les étapes-clés qui garantissent la sauvegarde de ce patrimoine, de l’inventaire à la restauration.
Cette exposition rend hommage aux métiers liés aux musées, à la variété de ses collections, et à ce patient travail de l’ombre qui permet d’en révéler les richesses. Plusieurs niveaux sont proposés pour tous les publics, dont un parcours enfant, des livrets adaptés, et des dispositifs de médiation.


Mise en ligne 15 octobre
Cosmogrammes
20 septembre 2025 au 15 février 2026
19, rue Léon — 75018 Paris
Cosmogrammes présente l’œuvre profondément collaborative de Sara Ouhaddou, artiste française d’origine marocaine, qui explore les savoir-faire traditionnels en dialoguant avec des artisanes et artisans à travers le monde. Invitée par l’ICI, dans la continuité d’une relation artistique tissée au fil des années, elle signe sa première exposition monographique au sein une institution parisienne.
Broderies, verre, céramique, dessins, bijoux et photographies emblématiques de sa démarche sont réunis dans un parcours porté par la voix de l’artiste. Il révèle les processus de transmission réciproque au cœur de sa pratique, mêlant œuvres récentes et créations inédites. Conçue comme une archive vivante, avec la complicité du commissaire de l’exposition Ludovic Delalande, Cosmogrammes ouvre un espace de circulation entre récits, gestes et mémoires.

Mise en ligne 23 octobre
Espace Science Actualités
13 novembre 2015 : que dit la science des attentats ?
Du 23 septembre 2025 au 22 mars 2026
Après les attentats de novembre 2015, des chercheurs en sciences humaines et sociales se sont mobilisés d'une manière inédite. Quelles études ont-elles été réalisées ? Quels savoirs ces études ont-elles produits ?


Mise en ligne 12 octobre
Agnès Thurnauer
Correspondances
02 octobre 2025 au 08 février 2026
L’exposition propose un dialogue inédit entre l’œuvre contemporaine d’Agnès Thurnauer et l’art du XVIIIe siècle, offrant un nouvel éclairage sur cette période et soulignant sa résonnance actuelle. L’artiste engage une correspondance avec des maîtres tels que François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Antonio Canal, dit Canaletto, et des figures féminines emblématiques : Adélaïde Labille-Guiard, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, ainsi que des écrivaines ou scientifiques comme Madame de Staël ou Émilie du Châtelet.
Au XVIIIe siècle, bien que le statut des femmes artistes soit ambigu, certaines, issues de milieux privilégiés, parviennent à s’imposer dans le monde artistique. Labille-Guiard et Vigée-Lebrun notamment sont admises à l’Académie Royale de peinture en 1783, et un nombre croissant d’artistes femmes exposent aux Salons, intègrent des ateliers renommés et enseignent à leur tour.
L’exposition interroge en parallèle l’écriture comme outil d’émancipation, avec des œuvres représentant des femmes créatrices et théoriciennes. Ces pièces, confrontées aux enjeux contemporains, révèlent une lecture originale et particulièrement vivifiante de l’art des Lumières.
Cette carte blanche invite ainsi à redécouvrir les contributions des femmes à l’histoire de l’art et à la pensée, tout en ouvrant un dialogue fécond entre passé et présent.

Mise en ligne 15 octobre
“Mandorla, les métamorphoses du sacré”
5 octobre au 8 mars
Abbaye de Maubuisson
Horaires : Voir les horaires d'ouvertures
Adresse : Av. Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Tél. : 01 34 33 85 00
Tirant son nom du mot italien signifiant “amande”, Mandorla renvoie à une figure symbolique majeure dans l’iconographie chrétienne : celle de l’ovale lumineux formé par l’intersection de deux cercles, image de la rencontre entre le céleste et le terrestre, entre le spirituel et le corporel. L’exposition propose une relecture contemporaine de cette zone d’interpénétration des contraires, véritable matrice du sacré et de ses multiples résurgences. Pensée comme une traversée des seuils – entre les âges, les cultures, les corps et les imaginaires – Mandorla met en regard une sélection de sculptures de saintes portant leurs martyrs, provenant du Musée Krona à Uden (Pays-Bas), avec des œuvres contemporaines dans un dialogue fertile. Sculptures médiévales, dessins, photographies, installations, vidéos et objets rituels viennent ainsi célébrer le sacre de la chair, de la vie et de la nature et la résonance entre l’intime et l’universel.
Avec Gaylene Barnes, Lara Blanchard, Hildegarde de Bingen, L. Camus-Govoroff, Alexandra Duprez, Charles Fréger, Annabelle Guetatra, Balthazar Heisch, Lauren Januhowski, Kate MccGwire, Rachel Labastie, Yosra Mojtahedi, Armelle de Sainte Marie, peggy.m & Scarlett Owls, Chloé Viton.

Mise en ligne 3 octobre
Députées en 1945 : De l’ombre à l’hémicycle
Du mercredi 8 octobre 2025 au dimanche 8 mars 2026
Corridor de Perpignan
Le 21 octobre 1945, pour la première fois en France, les femmes peuvent voter… et être élues. L’exposition Députées en 1945 : de l’ombre à l’hémicycle, présente les 33 premières élues à l’Assemblée nationale. Elle met en lumière leurs parcours et leurs engagements à travers une sélection de documents personnels inédits.
C’est le 21 avril 1944 qu’une ordonnance du Comité français de libération nationale (CFLN) accorde aux femmes le droit d’être « électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Cette décision est l’aboutissement d’un long combat pour l’égalité et reconnait également la contribution des femmes dans la lutte contre l’Occupant.
Dès les élections législatives constituantes du 21 octobre 1945, 310 candidates se présentent. Infirmières, journalistes, secrétaires ou ouvrières, elles sont le plus souvent résistantes, certaines d’entre elles ayant même été déportées dans les camps de concentration nazis. 33 sont élues et siègent parmi les 536 députés de la Nation. Cependant, cette proportion de 5,6 % chutera lors des scrutins suivants et ne retrouverale le niveau qu’à partir des années 1990.
Cette exposition rend hommage aux premières députées françaises en présentant des objets et documents illustrant leur travail parlementaire, ainsi que les jalons qu’elles ont posés sur le chemin vers la parité dans la représentation politique.


Mise en ligne 10 octobre
Les gens de Paris, 1926-1936
Dans le miroir des recensements de population
Exposition du 8 octobre 2025 au 8 février 2026
En prenant pour point de départ trois recensements de population, réalisés à Paris en 1926, 1931 et 1936, l’exposition Les gens de Paris, 1926-1936 renouvèle le regard sur la population parisienne de l’entre-deux-guerres.
Depuis le début du 19e siècle, Paris connaît une croissance démographique continue, avec un pic de population identifié en 1921 (2,89 millions d’habitants), jamais égalé depuis. Pour connaître le chiffre et la composition de la population, Paris, comme chaque commune française, procède tous les cinq ans à un recensement donnant lieu à la publication de statistiques. Mais, à la différence des autres communes, la capitale n’a jamais dressé de liste nominative des personnes avant 1926, ce qui rend ces trois recensements de 1926, 1931 et 1936, conservés aux Archives de Paris, sans précédent.
Souvent consultés lors de recherches généalogiques, ces registres invitent à se lancer dans une enquête inédite sur la population parisienne d’il y a cent ans. Partant de la structure générale bien spécifique de la population parisienne, le portrait des Parisiennes et des Parisiens est dressé en quatre étapes, des lieux de naissance et nationalités aux professions exercées, en passant par les situations familiales et la répartition au sein de chaque quartier et immeuble de la ville.
Une mosaïque de récits de vie les plus variés émerge dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions. Cette exposition invite à mieux se – et nous – connaître et reconnaître, individuellement et collectivement.
Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible sur le site Internet du musée pour préparer la visite : https://www.carnavalet.paris.fr/enseignants-animateurs


Mise en ligne 10 octobre
L'empire du sommeil
du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026
musée Marmottan Monet
Placée sous le commissariat de Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences, et de Sylvie Carlier, directrice des collections du musée Marmottan Monet, cette manifestation interrogera la portée symbolique et allégorique du sommeil, son importance dans l’iconographie profane et sacrée, et l’influence que les recherches scientifiques, philosophiques et psychanalytiques liées au sommeil ont eu dans le champ de l’art.
L’exposition se focalisera sur la période du XIXe siècle et du XXe siècle, périodes de grandes transformations sur l’imaginaire du sommeil. Le corpus d’œuvres des années 1800 à 1920 sera mis en regard d’œuvres significatives de l’Antiquité, du Moyen Âge, des Temps Modernes et de l’époque contemporaine pour rendre compte de la permanence de certains thèmes clefs : le sommeil de l’innocent, le songe des récits bibliques, l’ambivalence du sommeil entre repos et repos éternel, l’éros du corps endormi, les rêves et cauchemars. L’exposition abordera également le mesmérisme et les troubles du sommeil par le biais d’une iconographie médicale et montrera comment certains artistes s’empareront de ces sujets. Enfin, une section de l’exposition dédiée à la chambre à coucher esquissera les us et coutumes prêtés à cet espace hautement symbolique.
Co-commissariat : Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences et Sylvie Carlier, directrice des collections du musée Marmottan Monet
Avec Anne-Sophie Luyton, attachée de conservation au musée Marmottan Monet


Mise en ligne 23 octobre
Denise Bellon. Un regard vagabond
du 9 octobre 2025 au 8 mars 2026
Le mahJ présente la première rétrospective consacrée à Denise Bellon, photographe humaniste, pionnière du photojournalisme et figure majeure du milieu artistique et surréaliste. À travers près de 300 photographies, objets, lettres et publications, cette exposition retrace son parcours exceptionnel, singulier et méconnu, des années 1930 aux années 1970.


Mise en ligne 5 novembre
George Condo
Du 10 octobre 2025 au 08 février 2026
Le Musée d'Art Moderne de Paris organise, avec le concours de l’artiste, la plus importante exposition à ce jour de l'œuvre de George Condo. À la fois peintre, dessinateur et sculpteur, George Condo développe un univers singulier nourri par une culture visuelle prolifique qui parcourt l’histoire de l’art occidentale des maîtres anciens à aujourd’hui.
Né en 1957 à Concord, New Hampshire, George Condo s’installe à New York en 1979. Il est rapidement introduit dans la scène artistique locale, travaillant notamment pour l’atelier de sérigraphie d’Andy Warhol. Il part ensuite pour Cologne, puis Paris, qui devient son lieu principal de résidence de 1985 à 1995. Sa grande connaissance de l’art européen le mène à développer une approche personnelle de la peinture figurative et un regard féroce sur son époque.
Après les deux rétrospectives consacrées par le musée en 2010 à Jean-Michel Basquiat et en 2013 à Keith Haring, deux artistes avec lesquels George Condo partagea une véritable amitié artistique, cette exposition est conçue comme le dernier chapitre d'une trilogie new-yorkaise, explorant l'émergence dans les années 1980 d'une nouvelle génération de peintres. Chacun à leur manière, ils ont contribué à remettre en question le médium de la peinture, ce que George Condo, le seul survivant de cette décennie, s’évertue à poursuivre depuis.
Organisée en dialogue avec l’artiste, l'exposition a pour ambition de retracer plus de quatre décennies de la carrière de George Condo en présentant les plus emblématiques de ses œuvres. De nombreuses œuvres provenant de musées américains et européens majeurs (le MoMA, le MET, le Whitney Museum of American Art ou le Louisiana Museum of Modern art) et de collections privées sont pour la première fois réunies à Paris à la faveur de ce projet.
L'exposition comprend près de 80 peintures, 110 dessins – regroupés dans un cabinet d’art graphique dédié – et une vingtaine de sculptures qui ponctuent le parcours.
Bien que rétrospective dans son contenu, l'exposition n'est pas présentée dans un ordre chronologique strict. Elle propose un parcours à travers des cycles et thématiques auxquels l’artiste revient sans cesse au fil de séries d’œuvres distinctes.
L’exposition donne à voir la richesse et la diversité de la pratique de George Condo par le biais de trois volets principaux : le rapport à l’histoire de l’art, le traitement de la figure humaine, et le lien à l’abstraction.
L’exposition
L’exposition s’ouvre sur les liens féconds entretenus par l’artiste avec l’histoire de l’art occidentale. Dans une salle rejouant les codes d’un grand musée de Beaux-Arts classique, se déploient des œuvres parmi les plus audacieuses jamais produites par l’artiste. Elles montrent comment, de Rembrandt à Picasso en passant par Goya et Rodin, Condo s’approprie les maîtres du passé pour les intégrer à son imaginaire foisonnant, où les figures criantes et inquiétantes sont légion.
Le parcours se poursuit avec la présentation d’un ensemble d’œuvres liées au Réalisme artificiel, un concept imaginé par Condo pour décrire des œuvres défiant toute chronologie. Réalisées dans le style et avec les techniques du passé, ces œuvres empreintes aussi des éléments à la culture du graffiti (série des Names Paintings, 1984) ou à l’imagerie du cartoon (Big Red, 1997), produisant un effet d’incertitude temporelle.
Ce volet de l’exposition s’achève avec la monstration conjointe de deux corpus où Condo reformule l’histoire de l’art à sa manière, soit par l’accumulation (série des Collages, à partir de 1986), soit par la confrontation (série des Combination Paintings, 1990-1993).
Une pause est ensuite prévue au milieu du parcours pour entrer plus intimement dans l’esprit de l’artiste. Un couloir est dédié à la relation fructueuse entretenue par Condo avec la littérature, et notamment aux collaborations menées avec les écrivains de la Beat Generation (William Burroughs, Allen Ginsberg, Brion Gysin…). Ce passage mène à un cabinet d’arts graphiques, regroupant dans un accrochage dense des œuvres sur papier qui retracent l’ensemble de la production de Condo, de ses premiers dessins d’enfant à ses encres et pastels les plus récents.
La représentation de la figure humaine est l’un des sujets principaux de l’œuvre de Condo. L’artiste s’emploie à dépeindre la complexité de la psyché humaine à travers des portraits d’êtres imaginaires qualifiés d’« humanoïdes ». Une section leur est dédiée, d’abord par une série de portraits individuels du début des années 2000 revisitant les codes néoclassiques, puis par une salle regroupant des portraits de groupes (série des Drawing Paintings, 2009-2012). La section se clôture par une salle consacrée à la série des Doubles Portraits (2014-2015). Elle permet d’aborder la dualité de l’esprit humain et la notion de « cubisme psychologique » inventée par l’artiste pour qualifier sa manière de représenter plusieurs émotions dissemblables dans un seul et même portrait.
La dernière grande section de l’exposition propose d’explorer le rapport de Condo à l’abstraction. Depuis ses débuts, l’artiste réalise des œuvres à la lisière de l’art abstrait, à l’instar de la série des Expanding Canvases (1985-1986), où la frénésie calligraphique en all-over vient brouiller la composition. La section se poursuit avec la monstration de plusieurs séries de monochromes – blancs (2001), bleus (2021) et noirs (1990-2019). Un focus particulier est fait sur la série des Black Paintings, avec une salle immersive invitant à l’introspection. L’exposition se termine par des œuvres récentes de la série des Diagonal (2023-2024), révélant la capacité insatiable de l’artiste de redéfinir son propre langage pictura


Mise en ligne 7 septembre
Otobong Nkanga« I dreamt of you in colours* »
Du 10 octobre 2025 au 22 février 2026
Le Musée d’Art Moderne de Paris présente à l’automne 2025 la première exposition monographique de l’artiste Otobong Nkanga dans un musée parisien.
Depuis la fin des années 90, Otobong Nkanga (née à Kano au Nigeria en 1974 et vivant à Anvers en Belgique) aborde dans son travail des thèmes liés à l’écologie, aux relations entre le corps et le territoire, créant des œuvres d’une grande force et d’une grande plasticité.
À partir de son histoire personnelle et de ses recherches témoignant de multiples influences transhistoriques, elle crée des réseaux et des constellations entre êtres humains et paysages, tout en abordant la capacité réparatrice des systèmes naturels et relationnels.
À la suite de ses études à l’université Obafemi Awolowo d’Ife-Ife au Nigeria puis à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et à la résidence d’artistes de la Rijksakademie d’Amsterdam, l’artiste développe un questionnement sur la notion de l’exploitation du sol tout autant que sur celle du corps dans son rapport à l’espace, à la terre et ses ressources. Elle examine les relations sociales, politiques, historiques, économiques à l’œuvre dans notre rapport au territoire, aux matériaux et à la nature et produit dans une pratique pluridisciplinaire (peintures, installations, tapisseries, performances, poésies etc.).
La notion de strates est centrale dans le travail de l’artiste – à la fois dans la matérialité de ses sculptures, interventions, performances et tapisseries, mais aussi dans sa façon de penser les relations entre les corps et les terres – relations d’échange et de transformation mutuelles. Otobong Nkanga explore autant la notion de circulation des matériaux et des biens, des gens et de leurs histoires entremêlées, que celle de leur exploitation, marquées par les résidus de violences environnementales. Tout en questionnant la mémoire, elle offre la vision d'un avenir possible.
Parcours de l’exposition
Sont rassemblés des installations emblématiques, des séries de photographies, des oeuvres récentes, un grand nombre de dessins dont certains datant des premières années de création et jamais exposés jusqu’à aujourd’hui. L’exposition propose une coupe transversale à travers l’oeuvre protéiforme d’Otobong Nkanga depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et trace la généalogie de sujets récurrents (comme l’extraction minière ou les différents usages et valeurs culturelles connectés aux ressources naturelles) mais dont l’actualisation plastique est en constante évolution. À cette occasion, l’artiste réactive certaines œuvres emblématiques en leur agrégeant des éléments nouveaux – réalisés in situ – dans une poétique de l'enchevêtrement, créant ainsi des connexions entre les formes, les matières ou les idées.
Les œuvres proviennent de collections publiques françaises et internationales (Castello di Rivoli, à Rivoli, Stedelijk Museum à Amsterdam, Fondation Beyeler à Bâle, Henie Onstad Kunstsenter à Sandvika, M UKA à Anvers, Centre Pompidou à Paris) et de collections particulières ainsi que du studio de l’artiste. L’œuvre majeure From Where I Stand, 2015 qui avait été acquise lors du dîner des Amis du musée d’art moderne de Paris en 2022 figurera également dans l’exposition.


Mise en ligne 29 octobre
Voir la mer
Du samedi 11 octobre au samedi 25 juillet 2026
Vous êtes venus Voir la mer, cet écosystème puissant et fragile, miroir de nos êtres et de nos civilisations. Voguez de ses abysses à ses doux rivages, rencontrez ses habitants humains et autres qu’humains, et partez à l’assaut de tout ce qui la menace.
Au commencement, franchissez l’estran, cette zone intermédiaire qui se découvre au gré des marées, et vibrez au rythme de l’océan avec Charlotte Gautier van Tour. Entrez en contact avec l’eau, le phytoplancton et son souffle, avant de vous laisser glisser Sous la surface. Au-delà de la zone de minuit, là où la lumière ne parvient plus à percer la colonne d’eau, rencontrez les habitants des abysses : des créatures d’outremonde, hybrides et fantasmées par Elsa Guillaume, mais aussi de véritables spécimens des profondeurs, prêtés par l’ONG Bloom. Nagez ensuite parmi les gorgones d’Ugo Schiavi. Sa forêt marine, composée de sublimes coraux, contient, à y regarder de plus près, autant de coquillages que de déchets plastiques. Car même sur le plancher océanique, sous des kilomètres d’eau salée, les humains impriment leur marque. A bord d’un navire d’exploration, sondez, avec Latent Community, les profondeurs inaccessibles. Ces écosystèmes fragiles, indispensables aux équilibres terrestres et à la régulation du climat, sont aujourd’hui dangereusement convoités pour les précieuses ressources qu’ils abritent.
A présent, attirés par la lumière crue du soleil qui se mêle à l’ondoiement de la surface, vous voilà pris Dans la vague d’Adélaïde Feriot. Tanguez sous l’effet du « sentiment océanique », ce vertige qui nous saisit face à l’immensité et à la démesure. De la houle tempétueuse à la clarté indolente des vacances, il n’y a qu’une brasse, et vous remettez enfin pied à terre, sur le rivage salé de Mathieu Lorry Dupuy. Là, profitez de l’insouciance paisible de la plage, ponctuée de vestiges plastiques charriés par les flots.
Sentez monter en vous le Vague à l’âme océanique devant les poissons de Rémi Lécussan qui frétillent sur le bastingage, au rythme des marées. 3 800 kilos de poissons sont pêchés chaque seconde dans le monde par une industrie de plus en plus destructrice. Evadez-vous avec Carla Gueye, qui défend une pêche artisanale, respectueuse des ressources halieutiques et qui contribue à préserver la mangrove. Et rappelez-vous que le maintien des équilibres est d’abord une question politique. Ana Mendes moque ainsi les dirigeants et lobbyistes qui chaque jour entérinent des arbitrages désinvoltes entre écologie et économie, en teintant de roses leur cravate et leur col blanc avec de l’Astanxanthi, ce colorant alimentaire destiné à maquiller la chair grise du saumon d’élevage.
Nous voici face à un océan chaviré, abîmé, exploité, sillonné par plus de 100 000 navires de commerce. Un spectacle hypnotique et assourdissant que nous montre Jacques Perconte. Face à cette étendue cernée de toutes parts par les activités humaines, comment inverser la vapeur et renouer un lien équilibré et respectueux avec l’océan ? Par l’engagement et les gestes du quotidien. En ramassant, comme vous y invite avec humour le collectif Hypercomf, les mégots de cigarette qui représentent 40 % des déchets plastiques retrouvés sur les plages européennes. En portant attention aux personnes exilées qui rebâtissent leur existence sur d‘autres rives sous l’objectif d’Émeric Lhuisset. En s’inspirant du courage des matelots et de leurs arts populaires revisités par Duke Riley. Car le véritable héroïsme contemporain, c’est de trouver les moyens de Rendre la mer et non plus de la prendre. Alors jetez vous à l’eau et rejoignez les défenseurs de l’océan !
Pour le public individuel, l’exposition se visite gratuitement et sans inscription du lundi au samedi. Tous les groupes sont invités à réserver un créneau de visite, en amont par ici

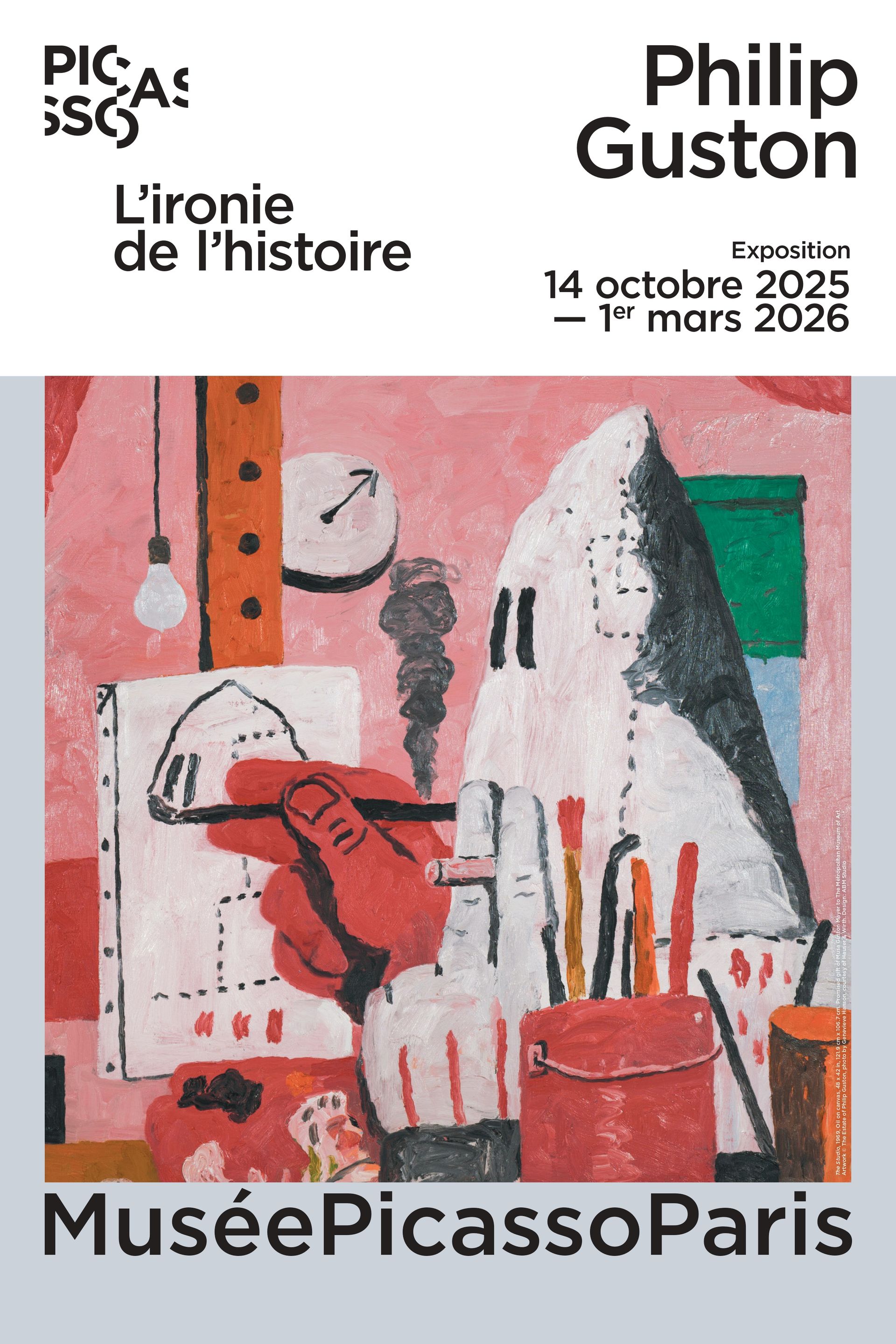
Mise en ligne 7 septembre
Philip Guston. L'ironie de l'histoire.
14 octobre => 7 mars 2026
Conçue autour des dessins réalisés par Guston en écho au livre de Philip Roth : Our gang, l’exposition mettra en lumière les liens de la peinture de Guston avec la verve satirique et caricaturale de ses dessins inspirés par le Président Nixon et son administration.
Au début des années vingt, Philip Guston est exclu de l’école d’art de Los Angeles pour avoir produit des images satiriques du corps enseignant. L’art ne cessera pour lui d’être l’outil d’un combat contre les figures d’autorité. Ses premières œuvres qui mettent en scène les exactions commises par les membres du KKK, sont vandalisées par les hommes cagoulés lors de leur exposition publique.
A la fin des années soixante, après avoir été un des protagonistes de l’école de New York, de la première avant-garde abstraite américaine, il fait scandale en revenant à une figuration inspirée de la bande dessinée.
En 1969, un écrivain en rupture de ban avec le milieu littéraire New Yorkais, Philip Roth s’installe à quelques maisons de l’atelier de Guston. L’écrivain vient d’entreprendre un ouvrage satirique qui met en scène le Président Nixon et son entourage (Our gang). Guston réalise plus de 80 dessins qui font écho au texte de Roth. Leur style, leur iconographie s’inspire des « planches » des Songes et mensonges de Franco réalisés par Picasso en 1937, de la causticité politique des dessins conçus par George Grosz pour le magazine Americana dans les années trente, de l’humour grinçant des planches de George Harriman qu’il admirait dans les quotidiens américains.
De la série des « Nixon Drawings » aux ultimes peintures de l’artiste, l’exposition du Musée Picasso mettra en lumière la porosité savamment entretenue par Guston entre la verve grotesque et caricaturale de ses dessins et la puissance expressive de sa peinture. Un transfert d’énergie s’y opère, nourri d’un humour noir qui confère à son œuvre une profondeur grinçante, faisant de lui une sorte de Kafka ou de Gogol de la peinture.
La Fondation Philip Guston et la fille de l’artiste Musa Mayer, soutiennent l’exposition, en confiant au musée l’ensemble de la série des Nixon Drawings ainsi que nombre d’œuvres inédites.


Mise en ligne 7 septembre
Raymond Pettibon
Underground
14 octobre => 1er mars 2026
En parallèle de l'exposition "Philip Guston. L'ironie de l'histoire", le Musée national Picasso-Paris consacre une exposition à l'artiste américain Raymond Pettibon, avec le soutien de la galerie David Zwirner. A travers soixante-dix dessins et une dizaine de fanzines, l'exposition explore l'univers ironique et dérangeant de cet artiste majeur de notre temps.
Artiste autodidacte, né en 1957 à Tucson, en Arizona, Raymond Pettibon fait son apparition à la fin des années 1970 sur la scène punk-rock californienne en réalisant les pochettes d'albums du groupe Black Flag, créé par son frère Greg Ginn. Il commence aussi à exposer et publier à son compte ses premiers dessins, qui s'inscrivent dans l'esthétique do-it-yourself des bandes dessinées, flyers ou fanzines, caractéristique du mouvement punk. Les dessins de Pettibon puisent à un large éventail de sources, de la littérature à l'histoire de l'art, de la culture populaire à la religion, de la politique au sport.
Résolument antiautoritaire, l'oeuvre de Pettibon brosse, à travers des images grinçantes, accompagnées d'inscriptions fracassantes, le portrait acerbe d'une société américaine nihiliste et violente, marquée par la fin du rêve hippie et le retour du conservatisme. Volontiers perturbante et indisciplinée, questionnant sans relâche le rêve américain, comme avait pu le faire en son temps Philip Guston - admiré par Pettibon - elle place le visiteur dans une situation inconfortable, le poussant à reconsidérer ses propres valeurs.


Mise en ligne 13 novembre
Flops ?!
Du 14 octobre 2025 au 17 mai 2026
Échec, raté, bide, fail, fiasco, déconfiture… le « flop » a de nombreux synonymes. Tant mieux, car il est si fréquent de rater qu’il faut avoir le choix du vocabulaire pour éviter la répétition. On estime que neuf innovations sur dix échouent et les raisons de la galère ne sont pas toujours évidentes ! Alors, pourquoi une invention ne trouve-t-elle pas son chemin ? Quelles formes peut revêtir l’échec ? Quelles leçons peut-on en tirer ?
En s’appuyant sur plusieurs cas d’école, l’exposition Flops ?! s’intéresse aux causes du ratage, dans différents secteurs techniques (transport, télécommunication, mécanique…) ou parfois un peu moins technique (jeux et jouets, communication graphique, biais psychologique…). Elle interroge l’ingénieur, le designer, le commercial, le publicitaire mais aussi l’utilisateur pour décortiquer les mécanismes de l’échec et mieux comprendre ce qui a cloché !
Et parce que certains flops se révèlent finalement des tops, l’exposition explore des trajectoires de réussite inattendues : celle d’une bonne idée qui était trop en avance sur son temps, d’une technologie encore immature, ou d’un objet qui a vu son usage détourné…
Bref, loin de se moquer des échecs, Flops ?! en propose une lecture bienveillante et met en lumière la nécessité d’oser et de rater, pour enfin innover.
L’accès à l’expo Flops ?! est soumis à une jauge limitée par créneau horaire. Après l’achat de votre billet d’entrée au musée, vous recevrez par e-mail un lien vous permettant de réserver un coupon d’accès à l’exposition, valable soit sur le même créneau que votre billet, soit sur un créneau ultérieur le même jour.
La visite de l’exposition dure 60 minutes.
Attention : le coupon seul ne permet pas l’accès au musée et doit impérativement être présenté avec un billet d’entrée valide. Nous vous remercions de bien respecter l’horaire réservé ; un retard maximal de 15 minutes sera toléré.


Mise en ligne 22 décembre
Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930
Exposition du 14 octobre 2025 au 14 juin 2026
Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 propose une relecture des films et photographies produits au cours d’une mission des Archives de la Planète menée par le missionnaire catholique Francis Aupiais et l’opérateur Frédéric Gadmer au Dahomey (actuel Bénin) de janvier à mai 1930. Une immersion en forme de dialogue franco-béninois qui questionne le regard porté sur les cultures extra-européennes, dans un contexte d’emprise coloniale et de naissance de l’ethnographie.
Présentation
La mission de 1930 au Dahomey est singulière à plusieurs titres : seule incursion des Archives de la Planète en Afrique sub-saharienne, dernière expédition d’ampleur avant l’arrêt du projet du fait de la faillite de la banque Kahn, elle résulte de l’initiative d’un homme d’Église atypique, le père Francis Aupiais (1877-1945). Ce père missionnaire, engagé dans une entreprise au long cours pour une meilleure connaissance des cultures africaines, entre en contact avec Albert Kahn en 1927 et le convainc de financer sa démarche de documentation des pratiques culturelles et religieuses dahoméennes, qui s’inscrit naturellement dans la lignée du projet humaniste du philanthrope. La mission s’étend sur quatre mois et demi au cours desquels Frédéric Gadmer réalise 1 102 autochromes (photographies en couleurs) et tourne 140 bobines de film, sous la direction d’Aupiais.
Ces films, les premiers de cette ampleur tournés au Dahomey, constituent le plus vaste ensemble de films des Archives de la Planète et l’un des premiers corpus filmiques de l’ethnographie française, cinq ans après la fondation de l’Institut d’ethnologie de Paris et un an avant la mission Dakar-Djibouti.
Bénin aller-retour questionne en outre la réception contemporaine des images de 1930 grâce aux regards d’artistes issus du continent africain. Servant de mise en perspective et de contrepoint critique, les œuvres de Ishola Akpo, Thulani Chauke, Sènami Donoumassou, Bronwyn Lace, Roméo Mivekannin, Angelo Moustapha et Marcus Neustetter, dont plusieurs ont été créées spécialement pour l’exposition, mêlent peinture, photographie, installation et performances, comme autant de réappropriations – et de réactivation – des photographies et des films.


Mise en ligne 15 octobre
Jardiner
Jusqu'au 12 juillet 2026
Dans un monde confronté à des défis environnementaux, sociaux et sanitaires majeurs, que signifie « jardiner » au XXIe siècle ? Une réflexion qui cheminera tout le long de votre promenade à travers la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie. Laissez-vous transporter dans une flânerie active et sensorielle où fleurissent les sciences cachées derrière le jardinage.
En six chapitres, l’exposition plante le décor ! Des installations très variées réinterprètent des jardins existants, tout en stimulant l’un de vos sens. Chaque univers est complété par une parcelle d’expériences, où enrichir votre culture.
Tout en déambulant, débroussaillez vos connaissances sur les relations inter-espèces, la biodiversité du sol, l’impact du climat sur les jardins, ainsi que les pratiques et bienfaits du jardinage... Apprivoisez espèces animales ou végétales de nos jardins traditionnellement mal-aimées. Semez votre graine d’inspiration sur « La fresque des jardiniers », une œuvre numérique évolutive, collective et vivante.
À la croisée des arts et des sciences, Jardiner offre une bouffée d’air frais pour renouer avec la nature !


Mise en ligne 19 novembre
Exposition : 150 ans du Palais Garnier
du 15 octobre 2025 au 15 février 2026,
à la Bibliothèque-musée de l’Opéra national de Paris (Palais Garnier)
Riche d’une centaine de pièces, tableaux, dessins, affiches, photos, livres, manuscrits, costumes et objets, l’exposition retrace l’histoire de ce théâtre où se mêlent patrimoine et création artistique, événements historiques et faits divers, fantasmes et légendes.
Elle permet de comprendre comment le Palais Garnier est devenu, au-delà des frontières françaises, un temple de l’art lyrique et chorégraphique, un emblème national et un monument iconique.
Depuis son inauguration, le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse d’exercer une fascination sur tous les publics, qu’ils soient sensibles, ou non, à l’opéra ou à la danse.
Plus d’un million de visiteurs et près de 350 000 spectateurs s’y pressent chaque année. L’exposition se propose d’explorer les différents ressorts de cette fascination, en se penchant sur la dimension à la fois historique, sociale et légendaire de ce théâtre connu dans le monde entier.
Palais national, cet édifice voulu par Napoléon III pour une élite est devenu un monument emblématique de la République. Palais de la danse pour le grand public, il est conçu à l’origine plutôt pour l’art lyrique avant que l’art chorégraphique ne s’y affirme. Palais des légendes enfin, il nourrit les imaginations, des faits divers aux fictions en tous genres qui participent depuis sa création à l’écriture du mythe.
Le palais national
Comme Louis XIV avait voulu Versailles pour y faire étalage de sa puissance, Napoléon III projeta dans le Nouvel Opéra son désir d’établir aux yeux de Paris, de la France et du monde, sa stature d’empereur.
Puis, le palais devint un symbole de fierté républicaine, le régime usant à l’envi de ce bâtiment comme le théâtre de son prestige et de son pouvoir, notamment à l’occasion des visites de chefs d’États étrangers.
Le geste d’André Malraux commandant un nouveau plafond à Chagall en 1962 atteste de la dimension toujours politique du Palais Garnier encore en plein XXe siècle. Si ce rôle diplomatique déclina peu à peu, le souvenir d’un palais national survit, alimenté par les bals des grandes écoles et des galas réguliers.
Le palais de la danse
Dans les premières années, le Palais doit sa notoriété davantage à son architecture et à sa décoration qu’au répertoire qui y est créé. Garnier pourtant conçoit son bâtiment en lien étroit avec la scène et crée un spectacle total dévolu à l’art lyrique.
Cependant, le Palais commence à montrer ses limites au fur et à mesure des évolutions du répertoire de l’Opéra, des attentes des metteurs en scène et de la demande des pouvoirs publics d’une démocratisation de l’art lyrique.
Dans le même temps, au cours des années 1920, la danse s’affirme grâce aux saisons des Ballets russes et à l’action de Serge Lifar qui érige la danse en art à part entière. Celle-ci prend une place croissante pour constituer l’une des singularités du Palais dans les années 1970.
La construction de l’Opéra Bastille finit de conférer au Palais Garnier sa dimension de temple de la danse, alors même que des spectacles lyriques de premier plan y sont toujours programmés et marquent, pour certains d’entre eux, l’histoire de l’Opéra de Paris.
Le palais des légendes
À partir de la première de Lohengrin en 1891, le répertoire wagnérien occupe majoritairement la scène du Palais Garnier et Parsifal, donné pour la première fois à Paris en 1914 lui confère un caractère sacré.
Puis, au début du XXe siècle, ce sont différents faits divers abondamment relayés par la presse et déformés qui contribuent à faire de l’Opéra un lieu chargé de légendes et de mystères : ce n’est plus un contrepoids, mais le lustre dans son entier qui s’effondre sur le public ; ce n’est plus un petit danseur, mais une danseuse qui se tue en traversant la verrière de l’escalier et marque à jamais la marche 13...
L’Opéra inspire aussi abondamment la littérature et le cinéma. Avec Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, publié en 1910, se construit la « légende noire » d’un Palais Garnier inquiétant et dangereux, à la réputation sulfureuse. Le cinéma s’empare à son tour du Palais, contribuant à lui donner un rayonnement international sans précédent.
Enfin, la programmation artistique ambitieuse, la venue de stars du chant, notamment La Callas, participent à la construction du mythe d’un opéra à nul autre pareil.

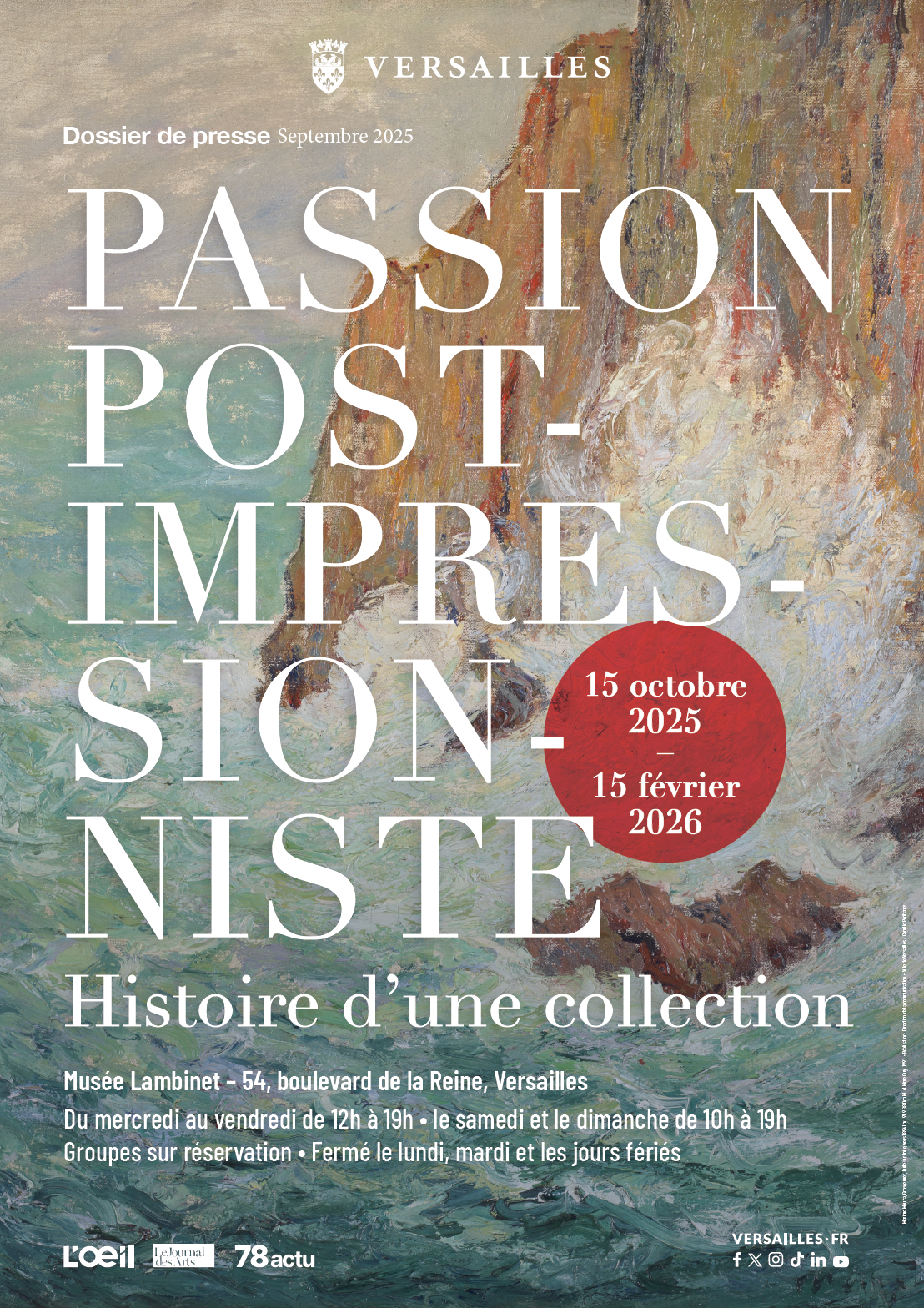
Mise en ligne 24 janvier
Exposition passion post-impressionniste
Du 15 octobre 2025 au 15 février 2026 au musée Lambinet
54, boulevard de la Reine, Versailles
La Ville de Versailles accueille au musée Lambinet l’exposition Passion post-impressionniste: histoire d’une collection du 15 octobre 2025 au 15 février 2026. Près de 50 oeuvres patiemment réunies par un couple de collectionneurs seront ainsi présentées parmi lesquelles les toiles de Paul Signac (1863-1935), Maximilien Luce (1858-1951) ou encore Maxime Maufra (1861-1918). Cette exposition a été l’occasion de procéder à la restauration de la quasi-totalité des peintures, d’une grande majorité de dessins et de revoir les montages et encadrements, nous permettant de les admirer avec un oeil neuf.
Il y a 21 ans, le musée Lambinet s’enrichissait considérablement grâce au legs de la collection de Fernande Guy (1903-2004) et Marcel Guy (1901-1991), constituée de peintures et de dessins post-impressionnistes de premier plan. En 2006, cette exceptionnelle collection avait déjà fait l’objet d’une exposition au musée Lambinet accompagnée d’un focus sur l’artiste Paul Signac.
Près de 20 ans plus tard, après une campagne inédite de restauration de la grande majorité de ses oeuvres, l’équipe du musée souhaite rendre une nouvelle fois hommage à ces donateurs et offrir aux visiteurs un nouveau regard sur ce fonds d’une qualité remarquable et à l’éclat retrouvé. Les visiteurs sont invités à redécouvrir la richesse de la palette de ces artistes de paysages et leur touche si particulière. Aujourd’hui encore plus qu’hier, cette collection, inscrite dans le goût de son époque est un atout considérable au sein des collections modernes du musée Lambinet. Cette nouvelle présentation répartie sur les quatre salles d’exposition au rez-de-chaussée du musée, est accompagnée d’un catalogue édité par les éditions Lord Byron.
L’exposition retrace la constitution de cet ensemble qui commence en 1946, après la guerre, avec leur premier achat, Champs de blé en Normandie par Gustave Loiseau. Leur collection s’enrichira de 24 peintures et 21 dessins, couvrant une période allant de 1880 à 1929. Elle rassemble des paysages de Paris, d’Île-de-France, de Bretagne et de Normandie créés par les figures majeures de la scène artistique de l’époque que sont Gustave Loiseau (1865-1935), Maximilien Luce (1858-1941), Henry Moret (1856-1913) ou encore Paul Signac (1863-1935).
Le post-impressionnisme regroupe tous les peintres qui ont cherché à aller au-delà de l’impressionnisme qui avait fait de la lumière son sujet de prédilection. Ce courant, qui n’est pas un mouvement unifié, inclut de nombreux styles et réunit des artistes qui s’expriment avec une grande liberté. Une nouvelle énergie singulière apparaît après 1880, et les artistes explorent de nouveaux langages picturaux ; le pointillisme, le synthétisme, ou encore le symbolisme. À l’intérieur de cet ensemble d’artistes s’expriment des personnalités à la fois très différentes mais caractérisées par ces recherches autour de la touche, de la couleur et de la structure qui annoncent les mouvements fondamentaux du début du XXe siècle comme le fauvisme ou l’expressionnisme.
Et ce sont ces artistes à la charnière entre l’impressionnisme du XIXe siècle et les mouvements audacieux du XXe siècle qui ont passionné le couple de collectionneurs Guy auquel le musée Lambinet rend hommage. De plus en plus fréquemment sollicités pour des prêts en France et à l’étranger en raison de l’engouement croissant pour les artistes de ce courant, ces oeuvres sont aujourd’hui rassemblées dans la ville de Versailles que leurs propriétaires avaient choisie avec soin pour en assurer la préservation et le partage au public.
La dernière salle de l’exposition fait la part belle aux artistes qui se taillent la part du lion dans la collection Guy : Gustave Loiseau et Maximilien Luce. Maximilien Luce, qui vient de faire l’objet d’une importante exposition au musée de Montmartre, fait partie des incontournables de la collection Guy. Caractérisé par une fibre sociale très importante, anarchiste revendiqué, Luce est aussi un peintre paysagiste exceptionnel, reconnaissable à sa touche pointilliste et de teintes vives, se jouant des contrastes entre de puissants mauves et des jaunes électriques comme dans Paris, vue de la Seine, la nuit, toile achetée en 1959 par les Guy.
Gustave Loiseau quant à lui peint des paysages en bords de rivières, notamment en Île-de-France, et ce à des heures particulières de la journée afin de capter une lumière singulière et avec l’intention de faire vibrer sa touche picturale.
Ce pointillisme ou ce divisionnisme exploré par la plupart des peintres post-impressionnistes rassemblés par les Guy, a été particulièrement mis en oeuvre par Paul Signac. Grâce au don, ces deux aquarelles de cet artiste majeur du néo-impressionnisme ont fait leur entrée dans les collections du musée Lambinet. Le Port de Cherbourg de 1932 nous laisse, par exemple, un témoignage vif et spontané du grand projet de l’artiste autour des ports de France.

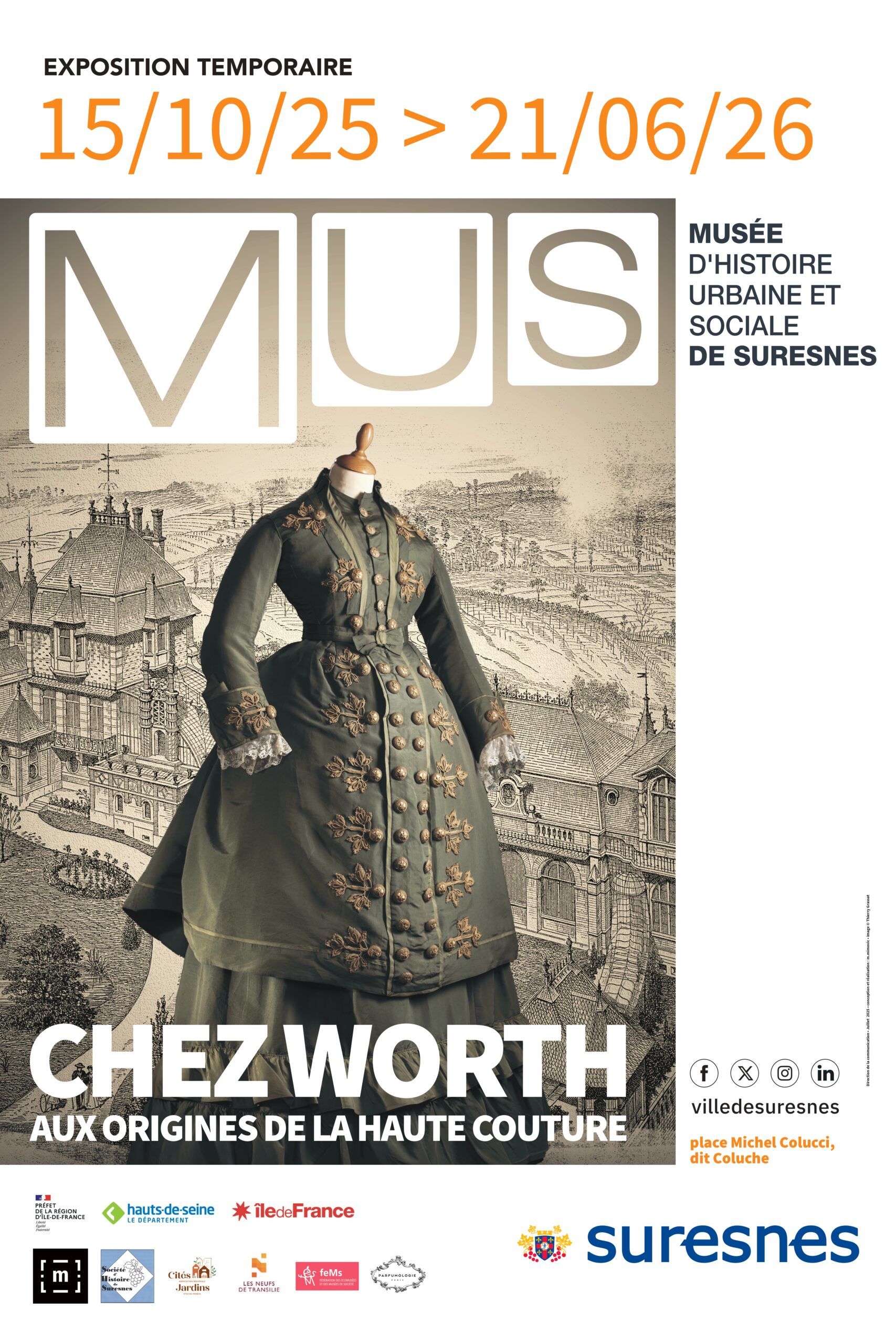
Mise en ligne 9 janvier
Chez Worth, aux origines de la haute couture
Du 15 octobre 2025 au 21 juin 2026
À l’occasion du bicentenaire de la naissance du couturier, le MUS vous présente une exposition temporaire consacrée à Charles Frederick Worth, le père de la haute couture, qui avait choisi Suresnes pour y construire sa résidence secondaire.
Avec plus d’une centaine d’oeuvres, inédites pour certaines, issues de 15 institutions et de collections particulières, l’exposition retrace la trajectoire hors du commun de ce jeune Anglais, arrivé en France à l’âge de 20 ans.
Racontant les origines de la maison de couture éponyme, replaçant les créations du maître dans le contexte politique et social du Second Empire, l’exposition livre également une vision intime de Charles Frederick Worth et sa famille.
Grâce à de rares documents et des objets personnels conservés dans la famille, vous découvrirez une personnalité hors du commun.
Plusieurs robes, costumes de bal et accessoires seront également présentés pour la première fois au public.
La scénographie originale confiée à Agostini et Simonneaux vous entraîne dans l’univers du luxe que Worth a su créer au sein de sa maison de couture et de sa résidence suresnoise.
Les dispositifs pédagogiques vous permettent d’entrer dans une ambiance olfactive inédite créée par Parfumologie – Fabrice Olivieri, de comprendre la mécanique des dessous avec une crinoline prêtée par l’Atelier du Tailletemps dans une crinoline contemporaine reprenant un tissu historique de Tassinari & Chatel et d’explorer le château Worth avec une maquette réalisée par l’atelier Scale.


Mise en ligne 13 novembre
Bilal Hamdad
Paname
Du 17 octobre 2025 au 08 février 2026
Dans le cadre de sa saison 2025, le Petit Palais accueille pour sa carte blanche d’art contemporain, le peintre Bilal Hamdad dont les œuvres explorent la solitude urbaine à travers des scènes parisiennes.
Diplômé des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbes en 2010 et des Beaux-Arts de Paris en 2018, il se distingue par ses grandes peintures à l’huile, souvent inspirées de photographies prises sur le vif. Ses tableaux mettent en lumière des personnages solitaires et anonymes, créant un contraste saisissant avec l’effervescence de la ville.
L’exposition au Petit Palais rassemble une vingtaine de ses œuvres, dont deux inédites, créées pour l’occasion, et établit un dialogue avec les collections permanentes du musée. Bilal Hamdad s’inspire de grands maîtres comme Rubens, Manet et Courbet, intégrant des références subtiles à leurs œuvres dans ses propres créations. Par exemple, sa peinture Miroir des Astres (2024) emprunte à l’esthétique baroque, tandis que Sérénité d’une ombre (2024) fait écho à la nature morte de Manet.
L’exposition invite les visiteurs à porter un nouveau regard sur les collections du Petit Palais et à explorer les paradoxes de notre époque à travers l’œuvre de Bilal Hamdad.

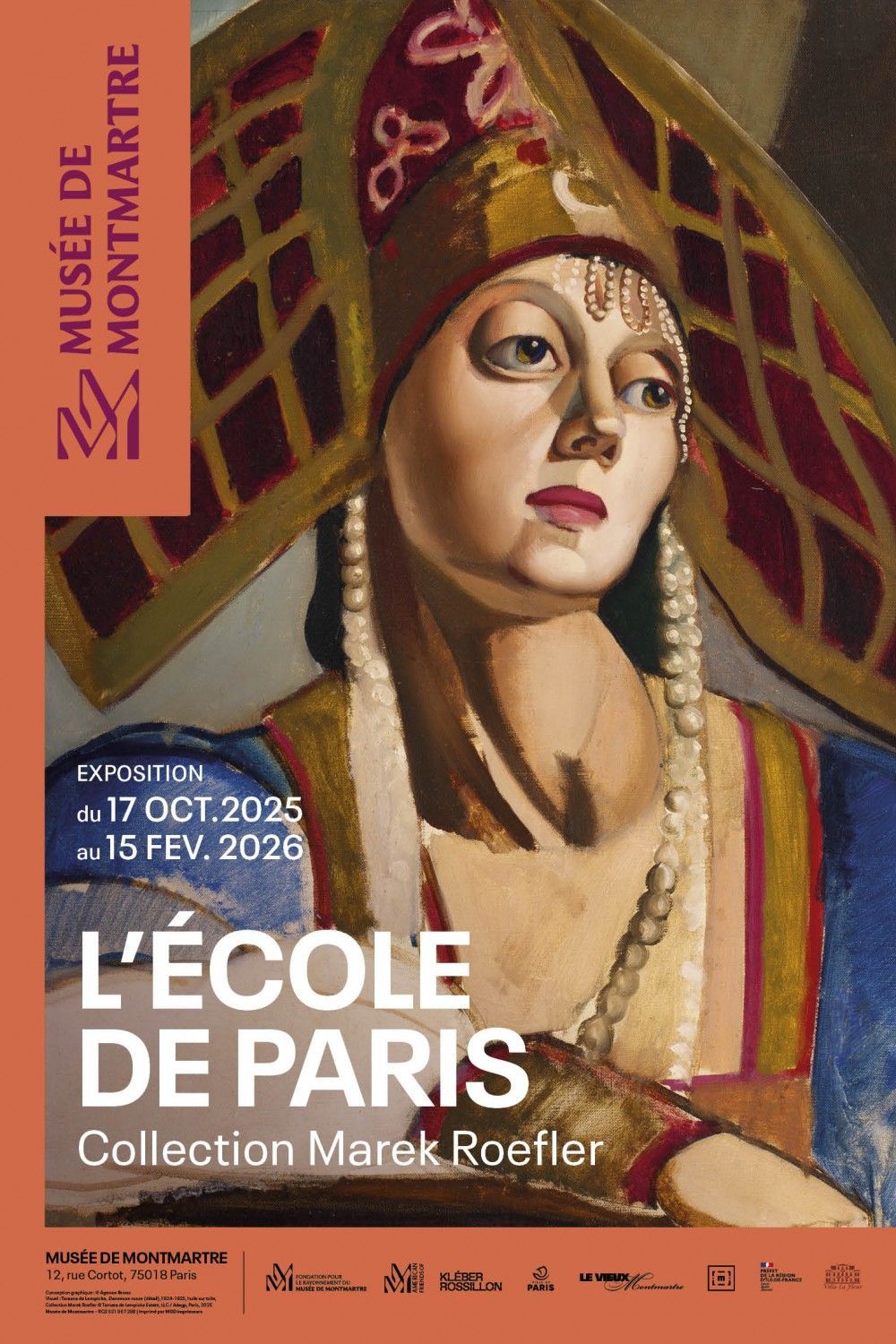
Mise en ligne 10 octobre
L’École de Paris, Collection Marek Roefler
Exposition du 17 octobre 2025 au 15 février 2026
Musée de Montmartre 12, rue Cortot - 75018 Paris
Le terme « École de Paris » a été utilisé pour la première fois en 1925 par le critique d’art français André Warnod. Il fait référence à un phénomène plus large : l’afflux d’artistes étrangers qui se sont installés d’abord à Montmartre et puis à Montparnasse avant la Première Guerre mondiale, et qui ont fait de Paris leur école d’art et de vie.
Parmi ces artistes venus principalement d’Europe centrale et orientale, nombreux étaient d’origine juive, mais on comptait également des artistes venus d’Espagne (Picasso), d’Italie (Modigliani), du Japon (Foujita), du Mexique (Rivera), de Grande-Bretagne et des États-Unis. Ce brassage artistique a permis à Montmartre et Montparnasse de devenir les berceaux des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Sous les pinceaux d’une multitude d’artistes internationaux le cubisme, le fauvisme, l’expressionnisme et le post-impressionnisme se côtoient et évoluent dans des milieux fertiles.
Suivant l’axe Nord-Sud – de Montmartre à Montparnasse – l’exposition « École de Paris, collection Marek Roefler » présente le fruit de nombreuses années de passion et de travail mené par le collectionneur, en faisant découvrir au public l’œuvre surprenant de plusieurs maîtres polonais. Les noms d’artistes reconnus tels que Ossip Zadkine, Tamara de Lempicka et Moïse Kisling, accompagnent ceux d’une génération souvent méconnue au grand public : Henri Hayden, Eugène Zak, Henri Epstein, Mela Muter, Maurice Mendjizky, Simon Mondzain, Wladyslaw Slewinski, Jozef Pankiewicz, Louis Marcoussis, Alice Halicka, ou encore les sculpteurs Auguste Zamoyski, Boleslas Biegas et Jozef Csaky.
Le parcours de l’exposition illustre l’étendue du foisonnement créatif de l’École de Paris, ainsi que la pluralité de styles qui caractérise ce mouvement. L’influence de Cézanne, Gauguin et de Van Gogh côtoie le développement autonome de plusieurs artistes, qui fondent leur propre esthétique sous l’égide de la libre pensée, dans les années où Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Ambroise Vollard et tant d’autres contribuent au rayonnement intellectuel et marchand des avant-gardes.
L’exposition s’inscrit dans la programmation du musée de Montmartre qui, depuis plusieurs années, invite à réfléchir sur la pluralité des parcours et met en lumière le rôle emblématique de la Butte dans l’histoire de l’art, ainsi que son effervescence créative.


Mise en ligne 19 octobre
Migrations et climat
Comment habiter notre monde ?
Du 17 octobre 2025 au 5 avril 2026
De la Vendée à Mayotte, du delta du Mékong aux îles du Pacifique, Migrations & climat explore l’impact des phénomènes naturels sur les circulations humaines et animales. Art, science et récits personnels s’entrecroisent dans une exposition-monde qui bouscule nos certitudes et invite à imaginer de nouveaux possibles, pour habiter au mieux le monde de demain.
L'exposition
Pour la première fois, le Palais de la Porte Dorée déploie dans l’ensemble de ses espaces, Musée et Aquarium, une exposition-monde : Migrations & climat.
Plus de 200 photographies documentaires, œuvres d’art - dont certaines inédites -, témoignages, vidéos, infographies et installations se conjuguent pour offrir une expérience de visite riche, immersive et profondément humaine
Les créations d’artistes internationaux comme Lucy + Jorge Orta, Inès Katamso, Margaret Wertheim, Ghazel ou encore Quayola, dialoguent avec les témoignages et récits de populations touchées par ces bouleversements aux quatre coins du globe, du Sénégal aux îles du Pacifique en passant par le Groenland ou la France.
Fruit d’un travail rigoureux
Fruit d’un travail rigoureux mené avec un conseil scientifique constitué d’experts internationaux, Migrations & climat donne ainsi à voir et à entendre, dans leur diversité, des réalités souvent méconnues, mises en lumière par les données issues d’organisations spécialisées mais aussi par les échanges au long cours avec des témoins ou des activistes des zones concernées.
En croisant les regards artistiques, scientifiques et citoyens, Migrations & climat éclaire un débat de société majeur, invitant à replacer l’humain et le vivant au cœur des préoccupations climatiques, culturelles et sociales. Une invitation en somme à repenser ensemble notre manière d’habiter la planète.


Mise en ligne 27 novembre
Les Mystères de l'Argent
L'Expo-Jeu
Du samedi 18 octobre 2025 au 8 mars 2026
Un événement pour petits et grands à Paris dès octobre 2025
À partir d’octobre 2025, la Cité de l’Économie vous invite à découvrir Les Mystères de l’Argent, une exposition ludique et interactive spécialement conçue pour les enfants de 6 à 12 ans… et leurs parents ! Si vous cherchez une activité en famille à Paris, une exposition pour les enfants, ou tout simplement un musée adapté aux plus jeunes, cette expo-jeu est faite pour vous.
Expliquer l’argent aux enfants ? Facile avec cette exposition amusante à Paris
D’où vient l’argent ? À quoi sert-il ? Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? En partant des questions que se posent les enfants, Les Mystères de l’Argent propose un parcours immersif, à la fois amusant, sensoriel et éducatif. Les familles pourront aborder ensemble un sujet souvent délicat avec légèreté, humour et pédagogie, dans un cadre unique : un véritable château en plein Paris, l’Hôtel Gaillard.
Une aventure à vivre en famille, entre jeux, énigmes et découvertes
Pensée comme un véritable voyage à travers le temps, l’exposition se déploie en 6 étapes immersives, de l’Antiquité au monde de demain. Les enfants explorent les grandes périodes de l’histoire monétaire, tout en expérimentant par le jeu :
Fabriquer des pièces en pâte à modeler
Manipuler un distributeur automatique
Soulever un sac de pièces d’or
Participer à des jeux de rôle
Relever des défis façon escape game
Et même… remporter une pièce en chocolat !
Les plus curieux trouveront également des jeux d’observation, des déguisements, un “cherche et trouve”, des espaces détente et des défis collaboratifs : de quoi ravir toute la famille, pour une sortie culturelle en famille à Paris mémorable.
Un musée pour les enfants… et pour les parents aussi !
Les Mystères de l’Argent est l'exposition du moment à Paris. Elle permet aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure, grâce à une scénographie innovante et aborde des notions économiques essentielles : échanges, valeur, inégalités, consommation… tout en stimulant leur esprit critique. Un livret de visite, disponible gratuitement à l’accueil, accompagne les enfants dans leur parcours.


Mise en ligne 10 octobre
Magellan, un voyage qui changea le monde
Du 22 octobre 2025 au 1er mars 2026
plongez dans l’une des plus grandes épopées maritimes de l’histoire, à travers une exposition immersive mêlant narration, projections monumentales et dessins d’animation. Cinq siècles après la première circumnavigation, le musée vous embarque au cœur du périple de Magellan, entre découverte, exploits et zones d’ombre.
Une odyssée maritime fondatrice
En 1519, Fernand de Magellan quitte Séville à la tête d’une flotte de cinq navires et de 237 hommes. Son objectif : rallier les îles aux Épices par l’ouest en franchissant un passage inconnu à travers le continent américain. Trois ans plus tard, une poignée de survivants revient après avoir accompli le tout premier tour du monde par la mer. L’exposition retrace cette odyssée fondatrice, depuis les motivations géopolitiques jusqu’aux conséquences humaines et historiques, en s’appuyant sur la série animée L’Incroyable périple de Magellan (Arte / Camera Lucida).
Une immersion scénographique au cœur du voyage
Guidé par Antonio Pigafetta, chroniqueur de l’expédition, le visiteur revit les grandes étapes du voyage dans un parcours immersif jalonné de projections géantes, de décors évocateurs et de récits incarnés. La scénographie met en lumière les tensions, les violences, mais aussi les découvertes et l’émerveillement, tout en posant un regard contemporain sur les représentations du monde à la Renaissance. Un voyage sensoriel et intellectuel, qui interroge l’héritage laissé par Magellan et les résonances de son aventure aujourd’hui.
Magellan, le parcours de l'exposition
Grâce à une mise en scène spectaculaire conçue avec Camera Lucida, Lucid Realities, l’exposition propose une plongée accessible à tous publics, du passionné d’histoire au jeune curieux. À travers une trentaine de modules audiovisuels, cartes animées et témoignages d’experts, elle invite à redécouvrir le premier tour du monde sous un jour nouveau, en résonance avec les enjeux contemporains du voyage, de la mondialisation et des représentations coloniales.


Mise en ligne 19 novembre
Paris 1925 : l'Art déco et ses architectes
Du 22 octobre au 29 mars 2026
Plongez au cœur des célébrations du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, un événement emblématique qui a marqué l’histoire de l’architecture et des arts décoratifs.
Cette exposition se déploie sur 200 m2 dans la galerie d'architecture contemporaine.
L’Exposition de 1925 : un manifeste pour la modernité
Inaugurée le 28 avril 1925 entre le Grand Palais et les Invalides, l’Exposition Internationale reflète le bouillonnement créatif d’une société d’après-guerre en pleine transformation. Véritable tremplin pour le style Art déco, elle met en avant des personnalités visionnaires tels qu' Auguste Perret, Henri Sauvage, Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens. Sous la direction de Charles Plumet, les pavillons audacieux construits pour l’occasion explorent de nouvelles approches architecturales, urbaines et décoratives, en dialogue étroit avec la nature.


Mise en ligne 29 octobre
1925-2025. Cent ans d’Art déco
du 22 octobre 2025 au 26 avril 2026
Voyage au cœur de la création des Années folles et de ses chefs-d’œuvre patrimoniaux avec l’exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco ». Mobilier sculptural, bijoux précieux, objets d’art, dessins, affiches et pièces de mode : près de 1 000 œuvres racontent la richesse, l’élégance et les contradictions d’un style qui continue de fasciner.
Cent ans après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui a propulsé l’Art déco sur le devant de la scène mondiale, le musée des Arts décoratifs célèbre ce style audacieux, raffiné et résolument moderne. Scénographie immersive, matériaux somptueux, formes stylisées et savoir-faire d’exception composent un parcours vivant et sensoriel, où l’Art déco déploie toutes ses facettes.
L’exposition se termine de façon spectaculaire sur le mythique Orient Express, véritable joyau du luxe et de l’innovation. Une cabine de l’ancien train Étoile du Nord ainsi que trois maquettes du futur Orient Express, réinventé par Maxime d’Angeac, investissent la nef du musée. Une invitation à explorer un univers où l’art, la beauté et le rêve s’inventent au présent comme en 1925.
Le commissariat général de l’exposition est assuré par Bénédicte Gady, directrice des musées, le commissariat par Anne Monier Vanryb, conservatrice des collections modernes 1910-1960 dans une scénographie de l’Atelier Jodar et du Studio MDA.


Mise en ligne 15 janvier
L’œil de Roger Corbeau : photographies de cinéma
Du 23/10/25 au 21/02/26
Considéré comme l’un des plus importants photographes de cinéma des années 1930 à 1980, Roger Corbeau a débuté sa carrière avec Marcel Pagnol et a contribué à l’univers esthétique de films tels que Toni de Jean Renoir, De Mayerling à Sarajevo de Max Ophüls, Macadam de Marcel Blistène et Jacques Feyder, Le Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, Pattes blanches de Jean Grémillon, La Fête à Henriette de Julien Duvivier, Les Parents terribles et Orphée de Jean Cocteau, Gervaise de René Clément, Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, La Loi de Jules Dassin, mais aussi M. Arkadin et Le Procès, d'Orson Welles et Violette Nozière de Claude Chabrol. Près de 150 films en 50 ans de carrière !
Fasciné depuis son adolescence par le cinéma et les acteurs, Roger Corbeau collectionne les photographies, les livres et les revues, qui ne cesseront de l’inspirer.
Maitre du noir et du blanc, il s’impose comme un grand portraitiste, puis apprivoise la couleur avec un goût très sûr. Son style singulier, immédiatement reconnaissable, fait de contraste appuyés ou d’effets charbonneux, sublime et immortalise Arletty, Brigitte Bardot, Faye Dunaway, Fernandel, Jodie Foster, Louis de Funès, Jean Gabin, Annie Girardot, Isabelle Huppert, Louis Jouvet, Sophia Loren, ou encore Jean Marais, Mélina Mercouri, Raimu, Simone Signoret et Michel Simon.
Réalisée à partir du fonds Roger Corbeau et de ses collections, l’exposition de la Fondation Pathé rendra hommage à un illustre photographe dont l’œuvre est à redécouvrir.
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
73 avenue des Gobelins, 75013 Paris

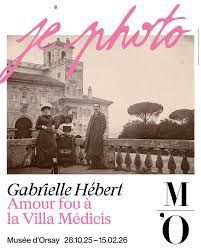
Mise en ligne 24 décembre
Gabrielle Hébert
Amour fou à la Villa Médicis
Du 28 octobre 2025 au 15 février 2026
Gabrielle Hébert (1853 - 1934), née von Uckermann, fut peintre amatrice avant d’épouser en 1880 Ernest Hébert, artiste académique renommé et deux fois directeur de l’Académie de France à Rome. Elle eut une pratique intensive et exaltée de la photographie, démarrée à la Villa Médicis en 1888 et terminée vingt ans plus tard à la Tronche (près de Grenoble) à la mort de l’homme qu’elle idolâtrait. Ernest Hébert était son aîné de près de quarante ans. Elle a en grande partie assuré sa postérité en favorisant la création de deux musées monographiques.


Mise en ligne 17 décembre
Pekka Halonen
Un hymne à la Finlande
Du 04 novembre 2025 au 22 février 2026
Le Petit Palais rend hommage, pour la première fois en France, à Pekka Halonen (1865-1933), l’une des figures majeures de l’âge d’or de la peinture finlandaise. Avec cette rétrospective inédite, le musée poursuit son exploration des grands artistes étrangers pour lesquels Paris, à la charnière des XIXe et XXe siècles, fut un catalyseur fondamental. Comme son aîné Albert Edelfelt (1854-1905) et son grand ami Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Pekka Halonen complète sa formation à Paris. C’est auprès de Paul Gauguin, dont il est l’élève en 1893, qu’il trouve sa voie et forge son idéal : chanter l’âme de la Finlande, à travers ses paysages et ses traditions ancestrales, et vivre son art en adéquation avec ses engagements. Né à Lapinlahti, ville du centre-est de la Finlande, en Savonie du Nord, et issu du monde paysan, Pekka Halonen baigne dès son plus jeune âge dans cette terre primitive dont il n’aura de cesse de restituer l’authenticité. Il ancre son attachement à sa terre natale dans la construction d’une maison-atelier, Halosenniemi, le long du lac de Tuusula, au nord d’Helsinki. Inlassablement, il y peint le spectacle de la nature, au rythme des saisons et au gré des lumières. La symphonie majestueuse des neiges, qui fascine l’artiste, constitue son terrain d’expérimentation privilégié, qu’il poursuit jusqu’à l’abstraction. Il y écrit sa propre modernité, sans cesse renouvelée à la lumière des avant-gardes parisiennes – le japonisme, le pleinairisme, le synthétisme ou encore le fauvisme. L’exposition, qui réunit plus d’une centaine d’oeuvres issues des plus grandes collections publiques et privées finlandaises, a été réalisée en partenariat avec le Musée d’Art de l’Ateneum – galerie nationale de Finlande (Helsinki).
Cette exposition est organisée en collaboration avec le Musée d’art de l’Ateneum – Galerie nationale de Finlande


Mise en ligne 14 janvier
« Les Ateliers d'art des grands magasins »
Du mardi 4 novembre 2025 au samedi 28 février 2026
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, la Bibliothèque Forney présente une exposition sur les ateliers d'art de quatre grands magasins parisiens : Primavera du Printemps, Pomone du Bon Marché, La Maîtrise des Galeries Lafayette et Studium Louvre des Grands Magasins du Louvre.
Créés entre 1912 et 1922, ces ateliers de création sont dirigés par des artistes décorateurs renommés : Charlotte Chauchet-Guilleré, Paul Follot, Maurice Dufrène, Étienne Kohlmann. Ils ont fait travailler tous les plus grands artistes qui inventent l'Art déco dans les domaines du mobilier, des tissus, de la céramique, du verre… En proposant des créations originales en petite série et à des prix attractifs, ils ont largement participé à la diffusion d'une nouvelle esthétique qui fait le lien entre l'Art nouveau du début du XXe siècle et les formes géométriques simplifiées qui seront à l'honneur dans les années 1930.
Leur participation à l'exposition de 1925 est particulièrement remarquée. Primavera, Pomone, Studium Louvre et La Maîtrise présentent chacun, dans un pavillon dédié, les dernières tendances du mobilier et de la décoration, contribuant grandement au succès de cet événement.
La bibliothèque Forney est riche sur ce sujet en catalogues commerciaux, affiches, papiers peints, photographies, objets publicitaires, catalogues d'expositions, périodiques, cartes postales.
Les œuvres sont donc issues en majorité de ses collections et de celles des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris mais aussi, pour le mobilier, les céramiques et le textile, d'autres institutions culturelles publiques ou de collections privées comme le Mobilier national ou les services Patrimoine des magasins du Printemps, du Bon Marché et des Lafayette, Tassinari-Chatel ou Pierre Frey, entre autres.


Mise en ligne 29 novembre
Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours
Du 5 novembre 2025 au 1er mars 2026
De Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar
Pour la deuxième grande exposition temporaire de la Cité internationale de la langue française, le Centre des monuments nationaux a choisi d’illustrer, la manière dont, au fil des siècles, l’objet manuscrit a été le support matériel et le témoin historique de l’évolution de la langue française, de ses usages divers et de ses métamorphoses.
L’exposition permettra d’admirer une centaine de documents d’exception issus des collections de la Bibliothèque nationale de France, du XIIe siècle jusqu’aux textes les plus contemporains, une traversée de Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar.
Parchemin ou papier, graphies élégantes ou convulsives, mises en page, illustrations, ratures, transformations, annotations... Dans l’univers de l’écrit, la singularité du manuscrit réside dans le choix du support, la graphie ou tout ce qui peut entourer le texte. Tout manuscrit est donc un témoignage vivant et unique de la langue telle que les individus se la sont appropriée au fil des siècles.
Simone de Beauvoir, Christine de Pizan, Marcel Pagnol, Boris Vian, George Sand, Mme de Sévigné ou Champollion : la Cité révèle des trésors de la Bibliothèque nationale de France, en donnant à voir les secrets d’écriture de nos auteurs et autrices parmi les plus célèbres à travers les siècles, que chacun a, à un moment, étudié en classe, découvert dans la bibliothèque familiale ou emprunté à la bibliothèque…
Commissariat d'exposition : Thomas Cazentre et Graziella Pastore, conservateurs au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.
Une exposition du Centre des monuments nationaux et de la Bibliothèque nationale de France, présentée à la Cité internationale de la langue française, soutenue par Beaux Arts Magazine et Lire Magazine.
Dix siècles d'histoire du français
Pour rendre compte de dix siècles d’histoire du français, l’exposition propose un voyage en cinq étapes, fondé sur le contenu des manuscrits conservés et sur leurs usages.
Penser en français
Cette première salle retrace, à travers des manuscrits savants, la manière dont le français s’est progressivement affirmé et développé comme une langue écrite capable de dire et de penser le monde. Le manuscrit devient le support de l’expression de la pensée, s’inscrivant dans une tradition de traduction et de transmission du savoir. À découvrir notamment dans cette section, les manuscrits de deux grandes femmes de science françaises : Emilie du Châtelet et Sophie Germain.
Parmi les œuvres à voir dans cette section : Jean-François Champollion, Grammaire égyptienne, 1830-1832 ; Thibaut Desmarchais, Le Secrétaire des astres, XVIIIe siècle ; Simone Weil, Cahiers, 1933-1941
La littérature avant l’imprimerie
Sous quelle forme se présentent les grands textes de la littérature française du Moyen Âge que nous lisons aujourd’hui dans des éditions imprimées ? Où ces textes ont-ils été produits et copiés ? À travers une sélection de manuscrits allant du xiie au xvie siècle, rédigés sur papier ou sur parchemin, cette section offre un aperçu de quelques exemples parmi les plus emblématiques ; elle illustre la spécificité matérielle de leur « mise à l’écrit » dans le vaste espace francophone médiéval. Du Roman d’Alexandre au Chansonnier cordiforme de Montchenu, le manuscrit avant l’invention de l’imprimerie est un véritable objet fini et esthétique.
À voir : Queste del Saint Graal, XIVe siècle (dernier quart, vers 1385) ; Chansonnier cordiforme de Jean de Montchenu, vers 1475 ; Gautier de Coinci, Miracles de Nostre Dame, 1328-1332
À entendre : Chansonnier cordiforme : diffusion d’un extrait de chanson (env. 3 min.)
Le brouillon littéraire
Témoignages précieux et émouvants de la naissance des grands textes de la littérature française, les brouillons littéraires autographes sont quasi inexistants pour le Moyen Âge, et restent rares jusqu’au XVIIIe siècle. Aux XIXe et XXe siècles en revanche, d’abondantes archives d’écrivains permettent d’observer et d’étudier la création dans tous ses états et ses déclinaisons individuelles. Les textes romanesques, dramatiques et autobiographiques présentés dans cette salle offrent, sous leur aspect initial parfois un peu ingrat en comparaison des manuscrits médiévaux, toute une variété de supports (feuilles libres, cahiers…), de graphies (certaines parfaitement limpides, voire élégantes, d’autres confinant à l’illisible), de mises en page (ordonnées, scolaires, ou au contraire saturées, voire chaotiques).
À voir : Marcel Proust, cahiers de brouillons pour À la recherche du temps perdu, 1908-1922 ; Wajdi Mouawad, Fauves, 2021; Colette, Les Vrilles de la vigne, 1908.
À entendre : Lecture par Denis Podalydès de Mort à crédit de Céline (INA) ; Extrait d’une pièce de théâtre : Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès (France Culture).
Écrire pour soi, écrire sur soi : les manuscrits intimes
L’écriture a longtemps été le privilège des clercs et des puissants. Cette pratique qu’il fallait
apprendre en des temps où l’école était rare, et dont les outils étaient coûteux, était réservée à un petit nombre et s’inscrivait dans un cadre social : on écrivait toujours pour quelqu’un, singulier ou multiple, proche ou lointain. La philosophie comme la morale chrétienne ont longtemps condamné la manifestation de l’ego, sauf dans le cadre du témoignage ou de la confession. Il a fallu des siècles pour que la pratique de l’écriture se répande, que de nouveaux groupes sociaux se l’approprient et que des individus s’en emparent pour raconter leur vie, confier au papier la chronique de leurs jours, de leurs sentiments, de leurs réflexions sur tout et rien, à l’intention de leurs proches ou de leurs descendants, ou pour eux-mêmes.
À voir : Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, vers 1789-1797
La correspondance
Écrire une lettre a sans doute été, jusqu’à une époque récente, la pratique d’écriture la plus universellement répandue ; le passage de la lettre manuscrite et de la carte postale au message électronique n’a fait que démultiplier la communication écrite. Or celle-ci a longtemps été une pratique très codifiée. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les lettres sont rarement personnelles, et s’appuient sur des modèles rhétoriques prescriptifs. À l’âge classique, l’écriture épistolaire se libère.
À l’époque contemporaine, des masses considérables de correspondances sont conservées dans les bibliothèques et les archives, publiques ou privées. Qu’elles soient produites par des personnalités historiques et littéraires ou de parfaits inconnus, toutes offrent des témoignages précieux et riches d’informations : sur la langue et sa pratique dans les divers milieux, sur une époque, sur les mentalités, les relations sociales… Au-delà de ces apports historiques, les lettres valent aussi par les voix singulières qu’elles font entendre, les sentiments et les pensées intimes qu’elles expriment, et la manière dont chaque correspondant, écrivain ou non, s’approprie littérairement et matériellement l’objet-lettre pour en faire une petite création sous enveloppe.
À voir : Ovide, Héroïdes, traduit en français par Octovien de Saint-Gelais, vers 1505-1515 ; Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, lettre à Madame de Grignan, 6 octobre 1688

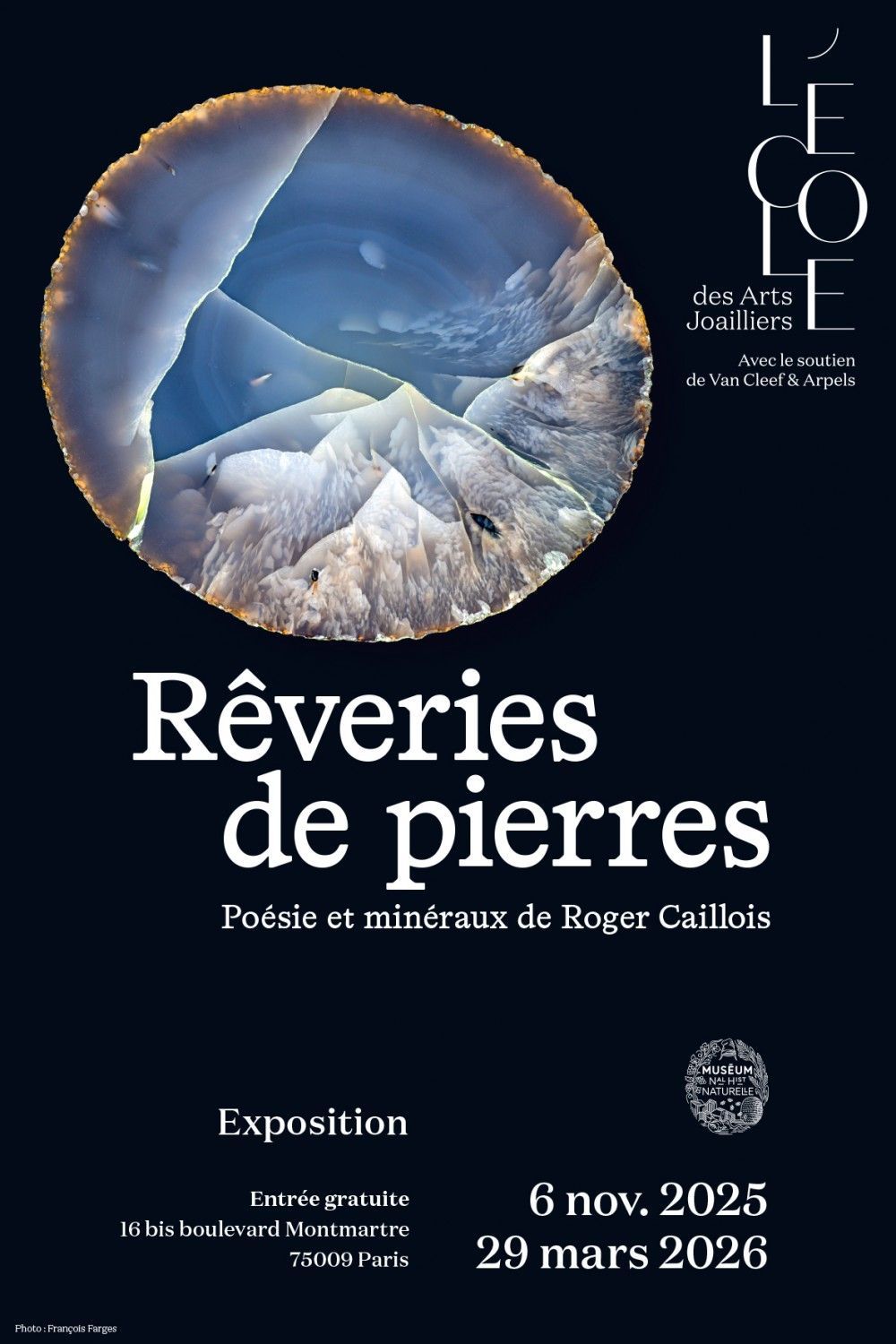
Mise en ligne 25 octobre
Exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois »
06.11.2025 — 29.03.2026
L’École des Arts Joailliers Hôtel de Mercy-Argenteau, 16 bis, boulevard Montmartre 75009 Paris
L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois.
Porté par une insatiable curiosité, doté d’une rigueur scientifique et d’une imagination foisonnante, Roger Caillois a collectionné les pierres avec passion et érudition pendant plus de vingt-cinq ans. L'ensemble constitué est en grande partie conservé au Muséum national d’histoire naturelle grâce, notamment, au mécénat de L’École des Arts Joailliers. Il regroupe plus d’un millier de minéraux.
Sa passion a donné naissance à une écriture d’une poésie rare : dès 1959, il publie des essais inspirés par sa collection de « pierres à images », dont L’Écriture des pierres, son ouvrage le plus célèbre, paru en 1970. Il est élu à l’Académie française l’année suivante.
L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits.
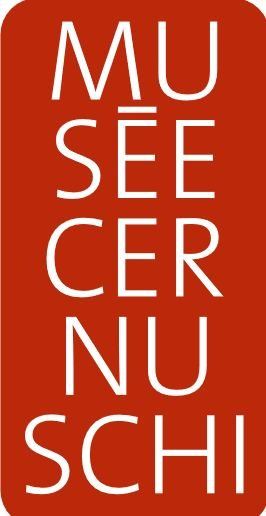

Mise en ligne 18 novembre
Chine. Empreintes du passé
Découverte de l’antiquité et renouveau des arts. 1786-1955
du 7 novembre 2025 au 15 mars 2026
Cette exposition, à découvrir actuellement, est une invitation à placer ses pas dans ceux des lettrés et moines archéologues qui parcouraient montagnes et sanctuaires en quête d’inscriptions antiques gravées sur la pierre ou coulées dans le bronze. Ces signes et formes archaïques inspirent des oeuvres dont la modernité naît de l’association inédite entre calligraphie, peinture et estampage : une rencontre qui témoigne de la révolution visuelle en cours dans la Chine du XIXe siècle.
L’étude des vases rituels et des stèles
Les lettrés de la dynastie Qing sont les héritiers d’une tradition de collectionneurs qui ont élevé l’étude des vases rituels et des stèles au rang de discipline scientifique. Ce champ du savoir, appelé étude des métaux et des pierres (jinshixue) a pour objet les inscriptions antiques. Au XVIIIe et au XIXe siècle, cette quête du signe amène les lettrés à se tourner vers les vestiges les plus modestes, ou les moins accessibles, comme les calligraphies gravées au flanc des montagnes.
La technique de l'estampage
L’instrument principal des collectes de ces savants était l’estampage encré. Cette technique consistait à appliquer sur les stèles des feuilles de papier humides qui épousaient creux et reliefs avant de les recouvrir d’une couche d’encre qui permettait de révéler le détail des graphies. Cette méthode d’abord utilisée pour conserver textes et inscriptions va progressivement être utilisée pour transmettre l’image de bas-reliefs historiés, de sculptures, et même de vases rituels dans leurs trois dimensions. En cet âge pré-photographique, l’estampage était un vecteur capital de reproduction et d’étude des vestiges du passé, dont la diffusion était assurée par le livre illustré.
Des créations inédites
Porteurs d’une vision esthétique, ces estampages, devenus à leur tour objets de collection, vont inspirer des créations inédites. Les formes simples et les graphies primitives qu’ils révèlent révolutionnent tous les arts lettrés, calligraphie, peinture et gravure de sceaux. Les peintres en particulier, font de l’estampage le support même de leur création. Progressivement, les arts décoratifs sont également gagnés par les motifs fragmentaires, l’esthétique de l’empreinte et du collage : l’univers des collectionneurs antiques se trouve transposé dans la culture matérielle des grands centres urbains de l’ère moderne.


Mise en ligne 18 janvier
De l’acier au papier. Regards sur le timbre gravé.
07 novembre 2025, 11:00 - 12 octobre 2026, 18:00
Musée de La Poste 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris
Pendant plusieurs mois, la photographe Sophie Brändström a saisi dans leur quotidien professionnel ceux qui font vivre le timbre gravé en taille-douce : illustrateurs, graveurs, imprimeurs et collectionneurs. Cette exposition vous propose de partir à leur rencontre à travers un parcours photographique et philatélique d’une exceptionnelle richesse.
- 07 novembre 2025, 11:00 - 12 octobre 2026, 18:00
Tous publics
Inclus dans le billet d'entrée au musée
Comment rendre visible un geste d’exception ? L’exposition photographique De l’acier au papier. Regards sur le timbre gravé propose une réponse sensible et inédite.
Le Musée de La Poste met en lumière l’art minutieux du timbre gravé en taille-douce, un savoir-faire rare – pratiqué seulement en France, Tchéquie et Chine – inscrit à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel.
Confiée à la photographe Sophie Brändström, membre de l’agence Signatures, cette enquête visuelle explore les gestes qui donnent naissance aux timbres-poste gravés, et rend hommage à celles et ceux qui assurent la pérennité de cet artisanat d’excellence : graveurs, imprimeurs, collectionneurs… C’est tout un écosystème philatélique qui est ici célébré.

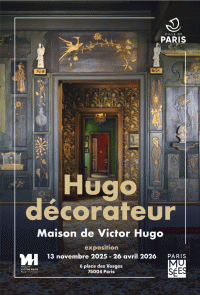
Mise en ligne 26 novembre
Hugo décorateur
13 nov. 2025 au 26 avr. 2026
La Maison de Victor Hugo est la seule institution à pouvoir témoigner, par ses collections, de ce domaine de la créativité hugolienne : la décoration. C’est la part la moins connue de son œuvre mais dont on observe la fascination qu’elle suscite chaque fois qu’on l’évoque, disparus ou impossibles à déplaçables sont autant de difficultés.
Cette exposition sur les deux étages du musée, tentera de rendre sensible et de documenter la méthode et l’esprit de Victor Hugo, décorateur.
Le parcours de l'exposition
La salle d’introduction propose « d’entrer dans le sujet » par la sensibilité avec des dessins de Victor Hugo où il met en scène ses propres décors ou bien reproduit des objets décoratifs qui semblent avoir arrêté son imaginaire.
« Les décors perdus »
Peu d’éléments subsistent sur le décor des appartements parisiens de Victor Hugo, avant l’exil : quelques objets, un seul dessin, l’arrière-plan de certaines peintures et des témoignages écrits. Le plus spectaculaire est la « bannière ottomane » qui ornait le grand salon de la Place Royale. Ceux-ci permettront cependant une évocation de ces décors.
Paris Guernesey : « Juliette »
Le goût des chinoiseries et des porcelaines, des bibelots et de la décoration a joué un rôle important dans la passion de Victor Hugo et de Juliette Drouet. Les témoignages sont nombreux et divers de cette complicité qui culmine avec les décors réalisés par Victor Hugo pour les deux maisons habitées par Juliette Drouet à Guernesey, visible au deuxième étage du musée.
Les échanges familiaux
Le décor est le lieu de la vie familiale ; il en est aussi l’expression. Des échanges en accompagnent la création : Victor Hugo offre coffres ou cadres peints aux siens, Mme Hugo façonne des cadres recouverts de velours, Charles y met la main ou chine des objets pour son père. Charles est aussi l’auteur du premier livre présentant Hauteville House qui devait être illustré à partir des photographies d’Edmond Bacot. Dans un précieux exemplaire le bibliophile Louis Barthou avait relié des dessins de Victor Hugo, recherche pour ses décors qui nous font entrer dans sa création.
« Hauteville House »
Pour évoquer Hauteville House, on proposera aux visiteurs la visite virtuelle de Hauteville House à 360°.
« La tour du Nord »
Après que les membres de la famille aient quitté Hauteville House, Victor Hugo condamna la salle de billard qui était le lieu emblématique de la vie familiale. Cette pièce devint une réserve dans laquelle le poète remisait les objets qu’il ne cessait d’acheter, en inlassable amateur, peut-être dans l’attente d’un éventuel, mais improbable, usage. À cette image, on se propose de donner une sorte de réserve ouverte de l’imaginaire décoratif de Victor Hugo, à travers ces objets flottants de Hauteville House, accumulés par le poète sans destination précise.
Dans l'appartement
L’intégration de l’appartement dans le parcours de l’exposition se justifie par les trois ensembles décoratifs qui s’y trouvent : le « salon chinois », la « salle à manger », la « chambre mortuaire ».
Souvenirs parisiens
Le salon rouge conserve plusieurs meubles qui faisaient partie du décors de l’appartement original place Royale.
Hauteville II, les panneaux peints
Le « salon chinois » est la pièce la plus spectaculaire du musée. Elle réunit les panneaux gravés et peints par Victor Hugo pour Hauteville II, la maison de Juliette Drouet à Guernesey, des céramiques et quelques meubles. L’ensemble était réparti dans plusieurs pièces de la maison de Juliette. Ils furent réinstallés au musée pour sa création, dans des disposition ne correspondant pas à celles d’origine, parfois même en coupant certains panneaux. C’est donc du faux fait avec du vrai.
Hauteville II, les meubles
Cette salle qui, comme la précédente sera complétée par la présentation de documents expliquant la façon dont Victor Hugo conçevait les meubles qu’il faisait réaliser par ses menuisiers.
Fascination
Le petit cabinet sera utilisé pour un accrochage de photographie des collections montrant la fascination qu’exerce Hauteville House sur des artistes contemporains
La chambre mortuaire
Cette salle constitue le troisième point fort de l’appartement avec le mobilier de la chambre dans laquelle Victor Hugo est mort.

Mise en ligne 14 novembre
Le Comte d'Artois, prince et mécène. La jeunesse du dernier roi de France
Du 14 novembre 2025 au 2 mars 2026
Une immersion dans la jeunesse d’un prince
En 1777, le comte d’Artois (1757-1836), frère de Louis XVI et futur Charles X, achète le château de Maisons pour y recevoir et s’adonner à la chasse. Il confie les travaux d’embellissement à François-Joseph Bélanger. Ils ne seront jamais achevés.
En juillet 1789, le Prince quitte la France et, en 1791, des scellés sont apposés sur le château qui passe cette période de trouble sans autre dégât notable que celui de la vente de l’ensemble du mobilier. L’exposition, en partenariat avec l’établissement public du
château de Versailles, se propose d’évoquer la jeunesse du comte d’Artois, futur Charles X, de sa naissance à son départ en exil en 1789. Les facettes les plus importantes du personnage seront abordées au travers de plus de 120 œuvres et documents variés provenant en grande majorité des collections du château de Versailles, mais aussi d’une vingtaine d’autres collections françaises, publiques comme privées.
Une expérience historique immersive au cœur du XVIIIe siècle
L’exposition débute par une présentation de château de Maisons au XVIIIe siècle. En complément aux gravures de la collection permanente déjà exposées, des projets du Prince pour le domaine seront évoqués à l’aide de plans et de dessins parfois inédits. Vous passerez ensuite aux premières années et à l’éducation du comte d’Artois, ainsi qu’à son mariage avec Marie-Thérèse de Savoie en 1773 et à sa descendance, avant d’aborder sa carrière militaire, qui, bien que purement honorifique et dénuée de toute importance stratégique, le conduisit brièvement sur un théâtre d’opérations en Espagne en 1779. Les divertissements du Prince, enfant gâté de la famille royale, seront ensuite abordés : principalement la chasse, mais aussi les sciences et une importante bibliothèque.
Les différentes résidences du comte d’Artois seront par ailleurs présentées, ainsi que les divers projets qu’il conçoit (notamment le château et le jardin de Bagatelle, création originale et majeure du Prince, et le vaste projet dû à l’architecte François-Joseph Bélanger pour le château de Saint-Germain-en-Laye). Quelques exemples représentatifs des créations d’ébénisterie réalisées pour les diverses résidences du Prince (Versailles, Bagatelle et Paris) et des commandes de porcelaine de Sèvres effectuées par la comtesse d’Artois dans le sillage de celles Marie-Antoinette, prendront place dans la salle à manger et le salon des Jeux. L’exposition se terminera par la fuite du Prince en 1789 et son exil en Écosse.


Mise en ligne 16 novembre
M.C. Escher
Du 15 novembre 2025 au 1er mars 2026
11 quai de Conti, Paris 6e
Pour la première fois à Paris, une grande rétrospective est consacrée à Maurits Cornelis Escher, l'un des artistes les plus fascinants et appréciés de la scène internationale.
Avec plus de 200 œuvres, l'exposition plonge le public dans l'univers imaginaire et vertigineux de ce génie visionnaire néerlandais. Né en 1898 à Leeuwarden (Pays-Bas), Escher a su conjuguer art, mathématiques, géométrie, logique et philosophie dans un langage unique, capable de défier les perceptions visuelles et de captiver des générations entières.
Célèbre pour ses visions impossibles, ses paradoxes visuels et ses géométries infinies, Escher est devenu une véritable icône, autant pour les mathématiciens et chercheurs que pour le grand public, séduit par la force visuelle et concptuelle de ses œuvres. Son travail se situe à la croisée de la rigueur scientifique et de l'imagination poétique, et a profondément inflluencé le monde du design, du graphisme et de la communication visuelle.
Ses illusions d'optique et architectures impossibles prennent vie dans cette exposition immersive, enrichie de stations interactives. À l'occasion de l'événement, accueilli dans les salons historiques de la Monnaie de Paris, seront également présentées des pièces commémoratives frappées pour les 100 ans de la naissance de l'artiste, ainsi que des dessins préparés pour des billets de banque finalement non émis en raison de leur complexité d'exécution.
L'exposition est produite par Arthemisia et Fever, en collaboration avec la M.C. Escher Foundation et Maurits, et est placé sous la direction de Frederico Giudiceandra et de Jean-Hubert Martin, deux des plus grands spécialistes mondiaux de l'artiste.
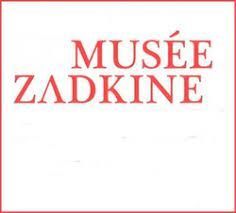

Mise en ligne 5 décembre
ZADKINE ART DÉCO
15 nov. 2025 — 12 avr. 2026
En 2025, le musée Zadkine célèbre les cent ans de l’Art déco en mettant en lumière les liens qu’a noués le sculpteur Ossip Zadkine avec les arts décoratifs dans les années 1920-1930. À travers plus de 90 œuvres – des sculptures, mais également des objets et du mobilier – l’exposition évoque, pour la première fois, les relations que Zadkine entretenait avec certains grands décorateurs de la période Art déco, tels Eileen Gray ou Marc du Plantier. Elle met aussi en évidence la parenté d’inspiration qui unit leurs créations.
Grâce à de nombreux prêts – provenant tant de collections privées que d’institutions prestigieuses, comme le musée des Beaux-Arts d’Anvers, la manufacture de Sèvres, le Mobilier national ou le musée des Années 30 à Boulogne – l’exposition permet de mesurer l’étendue du talent de Zadkine, artiste complet, passionné par la beauté et la variété des matières.
Celui qui entendait se comporter « comme un ébéniste des XIIIe et XIVe siècles qui se fiait toujours à son instinct », comme il l’écrit dans ses mémoires, garde un intérêt constant pour les savoir-faire empruntés à l’artisanat. Au début des années 1920, lorsque Zadkine, revenu du cubisme, cherche une voie nouvelle, il expérimente différentes techniques : il colore, dore et laque ses sculptures, donnant naissance à certains de ses chefs-d’œuvre comme l’Oiseau d’or, un plâtre doré à la feuille, ou le Torse d’hermaphrodite, laqué avec la collaboration du décorateur André Groult. C’est cependant sa maîtrise de la taille-directe qui lui vaut d’être sollicité pour l’Exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Aux côtés de sculpteurs comme Pompon ou les frères Martel, il participe au décor de la Pergola de la Douce France, un monumental édifice érigé sur l’esplanade des Invalides et qui entend remettre au goût du jour la technique ancestrale de la taille directe de la pierre, perçue comme plus authentique que le modelage.
L’exposition, conçue en cinq sections, explore dans un premier temps le « tournant décoratif » qui s’opère chez Zadkine dans les années 1920, moment où le sculpteur se passionne pour la couleur en sculpture et expérimente des techniques comme la dorure et la laque.
Une deuxième section met en avant les sculptures de Zadkine conçues pour l’architecture : Zadkine collabore en effet à plusieurs reprises avec des architectes pour décorer des monuments, à Paris comme à Bruxelles.
Les sections trois et quatre sont consacrées aux expositions de 1925 et 1937, auxquelles Zadkine a contribué. En cette année du centenaire, l’accent est mis sur l’Exposition de 1925 et sur la Pergola de la Douce France, l’un des rares monuments de 1925 encore conservés. Évoquée au musée Zadkine par le biais d’une maquette, d’esquisses et de documents, la Pergola est en effet remontée en 1935 à Étampes où il est toujours possible de l’admirer aujourd’hui.
L’exposition se clôt avec l’évocation de trois décorateurs dont Zadkine était proche : Eileen Gray, Marc du Plantier et André Groult. Dans l’ancien atelier du sculpteur, mobiliers et objets dialoguent ainsi avec des œuvres de Zadkine, présentées à la façon dont elles s’intégraient dans les intérieurs Art déco conçus par les créateurs renommés qui avaient su reconnaître son talent.


Mise en ligne 26 novembre
Dragons
18 nov.2025 01 mars2026
5000 ans d’histoires et de légendes des dragons d’Asie se révèlent à travers cette exposition conçue avec le Musée national du Palais de Taipei à Taïwan.
Le dragon originaire de Chine n’est en rien la créature maléfique et cracheuse de feu désignée sous ce nom en Occident. Il incarne plutôt l’énergie vitale universelle et l’élément aquatique. La terre dépend de sa toute-puissance pour bénéficier des bienfaits du ciel.
L’exposition Dragons présente une sélection exceptionnelle d'objets et oeuvres d'art, depuis les premiers dragons apparus sur les jades et bronzes antiques jusqu'aux formes populaires contemporaines, en passant par les arts impériaux.
Le dragon, seigneur céleste, poursuit son envol. Après avoir été l’emblème de la toute-puissance des empereurs, il continue de relier la terre au ciel pour apporter force et prospérité aux hommes.


Mise en ligne 19 novembre
Audaces d'un style
Les intérieurs sous le Consulat
Certains jours jusqu’au 9 mars 2026
À partir du 19 novembre 2025, le musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau consacre une exposition aux décors intérieurs sous le Consulat. Audaces d’un style explore la genèse d’une esthétique unique et inventive, située à la croisée des héritages classiques et des aspirations politiques d’un régime en mutation. Présentée au château de Bois-Préau, l’exposition prolonge et éclaire le parcours permanent de Malmaison, enrichi pour l’occasion d’œuvres inédites, offrant ainsi un regard renouvelé sur l’art consulaire.
Les dix années qui s’étendent de 1795 à 1804 voient s’épanouir un art de vivre foisonnant. Au goût de la fête de la jeunesse dorée et extravagante du Directoire répond, sous le Consulat, l’appétence pour le luxe d’une société en pleine recomposition. L’élégance des lignes et l’engouement pour l’exotisme, hérités du XVIIIe siècle, se conjuguent aux influences de Rome, de Pompéi, de la Renaissance, sans oublier celle de l’Égypte antique, que l’expédition du jeune général Bonaparte offre en prétexte renouvelé à une rêverie d’Orient.
Cette décennie voit également l’ascension politique du général Bonaparte. L’instauration du Consulat, puis du Consulat à vie, s’accompagne d’une redéfinition du cadre symbolique du pouvoir. La grandeur antique s’impose ici aussi comme modèle : le retour du siège curule, associé à la magistrature romaine, en témoigne. L’exposition retrace cette mise en scène du pouvoir, à travers les choix esthétiques et protocolaires du régime consulaire.
Audaces d’un style donne ainsi à voir — à travers quelque cent trente œuvres issues de collections publiques et privées prestigieuses (mobilier, objets d’art, textiles, dessins, arts graphiques) — l’avènement d’une grammaire décorative inédite, qui imprègne les intérieurs des personnalités les plus en vue. À la manière d’un carnet de tendances imaginé par un architecte de l’époque, elle invite le public à décrypter les formes, les motifs, les ornements et les couleurs qui traduisent ce renouveau stylistique.


Mise en ligne 10 octobre
Manga. Tout un art !
19 novembre 2025 - 9 mars 2026
Cet hiver, une vague manga déferle sur le musée Guimet !
Quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération, retrouvez vos héros préférés dans une exposition-événement exceptionnelle, déployée pour la première fois sur les trois étages du musée.
Admiré par plusieurs générations de lecteurs, le manga a conquis la France et le monde, qu’il s’adresse aux adolescents (shonen pour les garçons, shojo pour les filles) ou aux adultes (seinen, josei, seijin...) Mais connaissez-vous ses origines ? À travers des planches et des revues originales, mises en regard avec des objets et des œuvres graphiques de nos collections, l’exposition Manga. Tout un art ! lève le voile sur la naissance et l’évolution complexe de la bande dessinée japonaise. Des traditions millénaires aux premières influences occidentales, de la presse satirique aux premiers pas du dessin animé, de la créativité des maîtres mangakas des 20e et 21e siècles jusqu’à leur influence sur la mode et la haute couture, la galaxie manga n’aura plus de secret pour vous !


Mise en ligne 11 décembre
Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XXe siècle
du 19 novembre 2025 au 14 mars 2026
La Contemporaine présente son exposition « Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XXe siècle » du 19 novembre 2025 au 14 mars 2026. Le photomontage a profondément bouleversé les formes de la communication politique au XXe siècle. Fondé sur le découpage, le collage et la reproduction imprimée, ce procédé a permis d’orienter la lecture des photographies, désormais offertes à toutes sortes de manipulations et de combinaisons. L’exposition présente un panorama international de cette technique graphique et de ses usages militants, de la première guerre mondiale à la chute de l'empire soviétique.
Histoire politique et histoire des formes graphiques
Le photomontage est un procédé qui consiste à combiner plusieurs photographies ou fragments de photographies, de façon à créer des images composites, généralement diffusées par voie imprimée. Le parti pris de cette exposition est en effet de considérer le photomontage du point de vue des techniques graphiques, en mettant l’accent sur les gestes et les procédés qui président à la fabrication des images imprimées. Les pratiques de retouche, de montage et de « manipulation » des images, avant d’être instrumentalisées à des fins de propagande politique, trouvent en effet leur origine dans les pratiques de l’industrie des images.
Un panorama international : 250 pièces issues des collections de la Contemporaine et des prêts majeurs
En s’appuyant sur des travaux de recherche, les commissaires, Max Bonhomme (Université de Strasbourg) et Aline Théret (Contemporaine), mettent en valeur la diversité des supports imprimés : cartes postales, presse illustrée, affiches, couvertures de livres, tracts et brochures. Remontant au début du XXe siècle, l’exposition témoigne de l’inventivité des compositions présentes dans l’imagerie dès cette époque, notamment dans l’industrie de la carte postale, un support qui fut beaucoup utilisé comme moyen de propagande pendant la première guerre mondiale. Le parcours propose également un panorama international de l’histoire du photomontage, mettant en valeur aussi bien les productions soviétiques, allemandes, néerlandaises, italiennes qu’espagnoles. Si elle s’appuie sur les collections de la Contemporaine, très riches en presse illustrée et affiches politiques, elle les complète par de très beaux prêts d’institutions étrangères (International Institute of Social History, Amsterdam) et de collections particulières.
En proposant une traversée du XXe siècle sous le prisme de la manipulation des photographies pour les besoins de la communication politique, l’exposition invite tous les publics à faire résonner histoire des images prénumériques et actualité la plus récente.
Commissaires : Max Bonhomme, Université de Strasbourg et Aline Théret, la Contemporaine.


Mise en ligne 11 décembre
Momies
Du 19 novembre 2025 au 25 mai 2026
Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre spatio-temporel. Cette nouvelle exposition propose d’explorer l’histoire de quelques individus momifiés, de découvrir l’importance et la diversité de cette pratique à travers le monde, et d’interroger ses processus de patrimonialisation.
Intrigantes, fascinantes, parfois terrifiantes, les « momies » inspirent un grand nombre d’œuvres et de récits. On les retrouve dans les films, séries, livres et bandes dessinées, où elles sont enfouies dans des
tombeaux, dissimulées dans des
sarcophages
dorés, le corps couvert de
bandelettes
usées. Cette popularité a participé à forger un archétype de « la momie » qui les fige dans l’espace et dans le temps car, le plus souvent, ces images qui nous viennent à l’esprit renvoient à
l’Égypte antique.
Pourtant,
la momification est une pratique qui remonte à plus loin ! Les plus anciens corps momifiés connus à ce jour datent de 9 000 ans et appartiennent à la culture des
Chinchorros. Découverts sur un territoire situé entre le Pérou et le Chili actuels, ils sont une preuve que cette pratique existe à différents endroits de la planète.
En témoignent également
l’enfant momifié retrouvé en 1756 aux Martres-d'Artières, en plein cœur de la campagne auvergnate ; la
jeune reine de culture guanche provenant des îles Canaries ou encore
la « momie Chachapoya » des Andes péruviennes qui a été exposée au musée d’Ethnographie du Trocadéro dès 1878 et a inspiré le peintre Edvard Munch pour son célèbre tableau intitulé Le Cri.
Depuis les temps anciens,
la momification perdure et ce jusqu’à aujourd’hui, où elle est encore pratiquée dans de nombreuses sociétés.
À la rencontre des « momies »
L’exposition vous propose d’aller à la rencontre de personnes qui ont été intentionnellement momifiées, que ce soit en Amérique du sud, en Égypte, en France ou ailleurs, car si la momification naturelle existe, la majorité des personnes retrouvées momifiées l’ont décidé. Elle interroge aussi la place que ces individus occupent au sein de leur société, avant et après leur momification.
Alors que le corps est naturellement voué à disparaître, l’exposition vous invite à explorer les raisons qui ont poussé tant de cultures à opter pour
l’une des pratiques les plus poussées en termes de préservation du corps.
Techniques et rites de momification
Présentés allongés, assis ou accroupis, le corps dénudé, habillé ou couvert de bandelettes, ces témoins du passé, dont l’apparence s’éloigne des clichés habituels, nous transmettent des indices sur la manière dont leur corps a été transformé pour pouvoir traverser les âges.
Ce processus très codifié fait appel à des spécialistes du funéraire et s’accompagne d’un certain nombre de rites. À travers quelques objets emblématiques, notamment du mobilier funéraire, des illustrations et des dispositifs pédagogiques, l’exposition vous fait découvrir
une grande variété de techniques et rites de momification.
De l’Égyptomanie aux enjeux de conservation des restes humains
À travers des archives inédites, l’exposition revient sur l’essor de l’archéologie et la création des musées dans son sillage. En effet, au XIXe siècle, l’archéologie est en vogue et les fouilles sont menées avec frénésie par les puissances coloniales. Ainsi, de nombreux corps momifiés intègrent les collections des musées occidentaux et attisent la curiosité du public, en particulier lors d’événements populaires et médiatisés.
Aujourd’hui, la démarche a évolué : les musées mènent des enquêtes de provenance et s’interrogent sur la trajectoire de ces défunts. Cette exposition est l’occasion de montrer les
réflexions éthiques qui sont menées, notamment au Muséum, autour des enjeux de conservation et de présentation.
Des recherches scientifiques pluridisciplinaires
Enfin, l’étude scientifique des défunts momifiés fournit des réponses inédites sur les vies passées. Qui étaient-ils ? Quel était leur mode de vie ? À quoi pouvaient-ils bien ressembler ? Quel était leur condition physique avant de mourir ? Avaient-ils contracté une maladie ? Quel était leur rapport à la mort ? Autant de questions qui traversent la recherche. Découvrez comment, aujourd’hui, les scientifiques étudient et reconstituent la vie de ces défunts momifiés.


Mise en ligne 11 décembre
Magdalena Abakanowicz, La trame de l'existence
Du 20 novembre 2025 au 12 avril 2026
Artiste majeure de la scène polonaise du 20e siècle, Magdalena Abakanowicz (1930-2017) a connu dès son plus jeune âge la guerre, la censure et les privations instaurées par le régime communiste. Inspirée par le monde organique, par la sérialité et la monumentalité, sa création possède une puissance et une présence indéniables, en résonance avec les problématiques contemporaines – environnementales, humanistes, féministes.
Radicale et pionnière, l’œuvre d’Abakanowicz a été régulièrement exposée à l’étranger, des États-Unis au Japon en passant par l’Europe, et plus récemment à la Tate Modern de Londres et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Le musée Bourdelle présente la première grande exposition dédiée à l’artiste en France, offrant des clés de lecture biographiques et politiques à travers un parcours chrono-thématique de 70 ensembles – 33 installations sculptées, 10 œuvres textiles, dessins et photographies. Dans les 600m² de l’aile Portzamparc, dont les murs de béton ont été rénovés pour l’occasion, l’exposition met l’accent sur sa production sculpturale monumentale, afin de redonner à l’artiste sa place parmi les grands sculpteurs du 20e siècle.
Le sous-titre de l'exposition, "la trame de l'existence", associe deux termes employés par l'artiste pour définir son œuvre. Elle considérait le tissu comme l’organisme élémentaire du corps humain, marqué par les aléas de son destin.
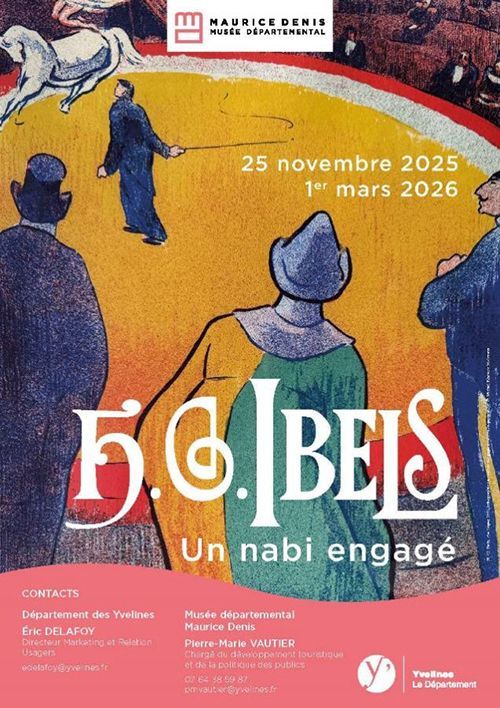
Mise en ligne 9 janvier
Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé
Musée départemental Maurice Denis
Du 25 novembre 2025 au 1er mars 2026
Première rétrospective consacrée à Henri-Gabriel Ibels (1867-1936), considéré à la fin du XIXe siècle comme un artiste de premier plan, cette exposition remet à l‘honneur une personnalité entière et engagée.
bels, le nabi journaliste
La carrière d’Ibels déconcerte par sa richesse et sa variété. Membre fondateur du
groupe des Nabis, il a manié la plume et le pinceau comme
Paul Sérusier et Maurice Denis, ses condisciples de l’académie Julian. Il s’est fait connaître pour
ses talents de dessinateur, de lithographe et d’affichiste, à l’instar de son ami
Henri de Toulouse-Lautrec. Toute sa vie, il s’illustre par voie de presse, d’où son surnom de « nabi journaliste ». Adepte d’arts appliqués, friand d’union entre les arts, il est devenu un collaborateur du metteur en scène et directeur de théâtre
André Antoine, et s’est également distingué comme
professeur d’histoire de l’art et d’histoire du costume,
devenant même chef d’un atelier de costumes. Mais c’est surtout son indéfectible engagement dans le combat social qu’a retenu la postérité, particulièrement son action dans
la lutte dreyfusarde, puis sa vie politique de radical-socialiste,
proche d’Aristide Briand, proclamant : « Mon arme : le crayon ».
Un artiste engagé
À travers ce portrait de Ibels, c’est le portrait d’une époque qui se dessine, celle des cafés-concerts, des grands magasins, des expositions universelles, et des grands débats politiques de la Troisième République. Et parce qu’elle fera une grande place à l’engagement citoyen, l’exposition sera accompagnée d’un projet dédié aux collégiens yvelinois en lien avec la maison Zola-musée Dreyfus, l’association Cartooning for Peace et des dessinateurs de presse professionnels.
« Une exposition d’intérêt national »
Le musée départemental Maurice Denis perpétue sa vocation originale de sortir de l’ombre les artistes Nabis oubliés dans l’historiographie : après les expositions Ker-Xavier Roussel (1994), Paul-Élie Ranson (1997-1998 et 2009-2010), Jozsef Rippl-Ronaï (1998-1999) et Georges Lacombe (2012-2013), il était temps de mettre en lumière un des artistes quelque peu marginalisés au sein du groupe car engagé politiquement au moment de l’Affaire Dreyfus. Ce travail de recherche primordial vaut à l’exposition d’être l’une des 28 expositions 2025 reconnues « d’intérêt national » par le ministère de la Culture. L’exposition est coproduite en partenariat étroit avec le musée Toulouse-Lautrec d’Albi qui l’accueillera à son tour au printemps 2026.


Mise en ligne 19 novembre
1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV
Exposition du 25 novembre 2025 au 3 mai 2026
En 1725, quatre chefs amérindiens et une femme amérindienne de la vallée du Mississippi sont reçus en France dans le cadre d’un voyage diplomatique inédit. Cet événement constitue le point culminant de relations que la couronne de France cherche à nouer avec les nations autochtones d’Amérique du Nord, sur fond de conflits entre les puissances coloniales européennes et leurs alliés amérindiens. Cette exposition offrira une occasion rare de découvrir l’histoire et la vie des nations amérindiennes de la vallée du Mississippi au XVIIIe siècle, leurs liens avec la France, l’extraordinaire traversée de l’Atlantique de leurs chefs, et la rencontre de ces derniers avec Louis XV, la Cour et la capitale.
La vallée du Mississippi autochtone au XVIIIe siècle
La première section de l’exposition plongera le visiteur dans l’univers complexe des sociétés amérindiennes de la vallée du Mississippi, à l’époque où les Français commencent à l'explorer et à s’y installer. Cette rencontre entre ces deux civilisations donnera bientôt naissance à une alliance durable, fondée sur des relations diplomatiques étroites.
L'exposition présentera d’abord les grandes nations amérindiennes au cœur de cette histoire, grâce à une carte contemporaine spécialement conçue pour l’exposition, et à des cartes rares du XVIIIe siècle. Certaines nations étaient déjà liées aux Français par des alliances nouées antérieurement, renforcées en 1701 par la Grande Paix de Montréal dont le traité historique sera exceptionnellement exposé au public.
À travers une série de portraits rares, parmi les seuls conservés de cette époque, se dessinera une toute autre image des sociétés amérindiennes loin des stéréotypes des peuples des Plaines du XIXe siècle. La sélection d'œuvres intègre une coiffe de plumes exceptionelle du XVIIIe siècle, probablement la plus ancienne de ce type conservée au monde.
La présentation des nations amérindiennes se prolongera avec un aperçu de leurs modes de vie, fondés sur une alternance entre vie agricole et chasse selon les saisons. Leur lien au vivant est aussi spirituel et passe par de véritables relations sociales entretenues avec des « personnes » autre qu’humaines comme les oiseaux-tonnerres, esprits puissants, qui ornent notamment les peaux offertes aux Français comme cadeaux diplomatiques.
L’établissement d’une colonie française : la Louisiane
La deuxième section de l’exposition mettra en lumière les liens étroits tissés entre les Français et leurs alliés autochtones après leur installation en Louisiane. Elle présentera une sélection d’objets illustrant le métissage culturel né au début du XVIIIe siècle : casse-têtes ornés de fleurs de lys, colliers de perles importées ou couteaux européens dans des fourreaux amérindiens. Un calumet de paix, richement décoré de plumes, et une peau peinte le représentant en seront les pièces les plus éloquentes.
En 1724, pour affermir cette alliance, la Compagnie des Indes propose d’inviter des chefs autochtones à la Cour du jeune Louis XV. Étienne Véniard de Bourgmont, commandant du poste du Missouri, sollicite les nations Otoe, Osage et Missouria − dont les réponses transcrites dans la correspondance diplomatique seront présentées dans l’exposition − tandis que les Illinois envoient Chicagou, le chef des Michigamea et transmettent la parole de Mamantouensa, chef des Kaskaskia, via un missionnaire jésuite, Nicolas Ignace de Beaubois.
La constitution de la délégation ne se fait pas sans peine. Alors que d’autres nations devaient envoyer des représentants, le naufrage du navire qui devait les emmener en France dissuade le plus grand nombre de poursuivre. Finalement, la délégation se compose de quatre chefs et de la fille d’un chef missouri et prend la mer au printemps 1725. Dès ce moment, les délégués sont considérés comme des ambassadeurs internationaux et un document nous apprend qu’ils sont traités « comme à la table du capitaine », honneur réservé aux seules élites.
La réception de la délégation à la Cour
Cette dernière section retracera les étapes de la visite des chefs amérindiens en France − à Paris, Versailles et Fontainebleau − et dévoile le protocole déployé par la Cour pour les recevoir, comme souvent pour les ambassades étrangères. Grâce au précieux témoignage du Mercure de France, on suit leurs déplacements : ils rencontrent les directeurs de la Compagnie des Indes, organisatrice du voyage, et les princes et princesses du sang. L'exposition mettra l’accent sur l'audience donnée par Louis XV aux chefs le 25 novembre 1725 à Fontainebleau. Cet épisode constitue le moment le plus symbolique de la visite au cours duquel les chefs prononcent des harangues destinées à Louis XV qui, en retour, fait preuve d’un intérêt tout particulier pour ses invités.
Après avoir visité Versailles, Marly et Trianon, les délégués ont l’honneur d’être invités à participer à la chasse à Fontainebleau, aux côtés du roi. Ils acceptent volontiers et prennent part à cet événement « à leur manière », c’est à dire à pied, et munis de leurs arcs.
Le parcours de l’exposition, ponctué de citations du Mercure de France, présentera différents présents similaires à ceux échangés entre les Amérindiens, le roi et le gouvernement : de prestigieuses coiffes, des arcs et un calumet pour les premiers, une médaille en or et autres riches artefacts pour les seconds. Des portraits des principaux acteurs de l'événement côté français ainsi que le portrait jamais exposé en France d’un Amérindien Miami permettront d’illustrer cette rencontre entre la Cour et la délégation, en la restituant dans toute son esthétique.
L'exposition évoquera en point d'orgue la « danse des Sauvages », célèbre pièce composée par Jean-Philippe Rameau et ajoutée à son opéra Les Indes galantes, qui lui a été inspirée par la danse de deux chefs sur la scène de la Comédie-Italienne. Cette source d’inspiration, rarement évoquée en France, montre l’impact durable de cette délégation sur la culture française, unique à l'époque.
Enfin, une médiation spéciale permettra aux visiteurs d’écouter les membres autochtones du conseil scientifique de l’exposition évoquer le rapport contemporain de leurs nations avec la France, en écho à cette longue histoire partagée.


Mise en ligne 24 décembre
Joyaux dynastiques
Pouvoir, prestige et passion, 1700-1950
10 décembre => 6 avril
Le bijou, expression intemporelle de pouvoir et de prestige, se révèle ici aussi comme un objet intime, porteur de sentiments et messager de faveurs royales, de passion. L’exposition rassemble des joyaux associés au règne de figures emblématiques de l’histoire européenne telles que les impératrices Catherine II de Russie, Joséphine, Marie-Louise d’Autriche, et la reine Victoria.
Pierres, diadèmes, broches et colliers composent un langage fastueux, celui des cours royales, où chaque gemme révèle le statut, la lignée et l’autorité de son illustre détenteur.
À l’occasion du troisième volet d’une trilogie d’expositions organisée en collaboration avec le Victoria and Albert Museum. Cette exposition réunit des joyaux historiques et d’une importance majeure provenant à la fois des collections du prestigieux musée londonien le V&A et de la Collection Al Thani, dont beaucoup sont exposés en France pour la première fois.
L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels d’institutions tellesque la Royal Collection, grâce à la générosité de Sa Majesté Charles III, les Historic Royal Palaces grâce à la générosité de Sa Grâce le duc de Fife, le musée national du château de Compiègne, le domaine national du château de Fontainebleau, le Muséum national d’histoire naturelle, le musée de Minéralogie MinesParis – PSL, ainsi que les collections patrimoniales de Cartier, Chaumet, Mellerio et Van Cleef & Arpels.

Mise en ligne 24 décembre
Rodin. Dessins libres
Du 13 décembre 2025 au 1er mars 2026
Si Auguste Rodin est universellement reconnu comme sculpteur, il fut aussi un dessinateur passionné. "C'est bien simple : mes dessins sont la clé de mon œuvre" confiait-il au journaliste René Benjamin en 1910.
A travers une sélection de près de 70 dessins provenant exclusivement de la collection du musée, l'exposition révèle une pratique qui se réinvente sans cesse, des années de formation aux dessins lumineux de la maturité. L'art du fragment, le goût de la série, la visibilité du geste, les recherches sur la couleur placent Rodin aux avant-postes de la modernité.


Mise en ligne 21 janvier
Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode
Du 13.12.2025 au 18.10.2026
En décembre 2025, le Palais Galliera inaugure une série d’expositions consacrées aux savoir-faire. Au cours de trois expositions successives, qui aborderont les métiers et techniques de la mode sous différents angles, le musée met en lumière la richesse de ses collections et propose un nouveau regard sur l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours.
Cette première exposition est consacrée aux savoir-faire de l’ornementation – tissage, impression, broderie, dentelle, fleurs artificielles – qui permettent d’ennoblir et de décorer vêtements et accessoires. Ces techniques sont abordées à travers le thème de la fleur, motif incontournable dans l’art du textile et la mode depuis le XVIIIe siècle. Ses multiples déclinaisons permettent d’apprécier les jeux de matières, le traitement des couleurs, des volumes, ou le placement des motifs qu’il inspire au gré des saisons. Du textile broché d’un gilet du XVIIIe siècle à l’impression au laser d’un ensemble Balenciaga, d’une dentelle de Chantilly au camélia de Gabrielle Chanel, l’exposition met en avant la grande variété des techniques, tout en interrogeant leur symbolique et leurs usages.
Riche de plus de 350 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, arts graphiques, échantillons, outils…), le parcours révèle à la fois des créations de maisons de haute couture et des pièces de jeunes créateurs, dont certaines spécialement réalisées pour l’exposition. Des échantillons de textiles et des tables équipées de loupes invitent le public à observer, scruter et contempler les œuvres pour comprendre la complexité des gestes qui se cachent derrière chaque création – l’occasion unique de plonger au cœur des savoir-faire de la mode.
Le Palais Galliera met également à l’honneur les auteurs de ces savoir-faire souvent oubliés ou effacés derrière le nom prestigieux d’un couturier. Qu’il s’agisse de maisons historiques telles que Lesage ou Hurel, de nouvelles figures contemporaines comme Baqué Molinié ou Aurélia Leblanc, l’exposition revient sur les métiers souvent méconnus de la mode : créateur textile, brodeur, plumassier, parurier floral, qui ont fait de Paris, capitale cosmopolite, un territoire privilégié de ces savoir-faire d’exception, sans cesse renouvelés.

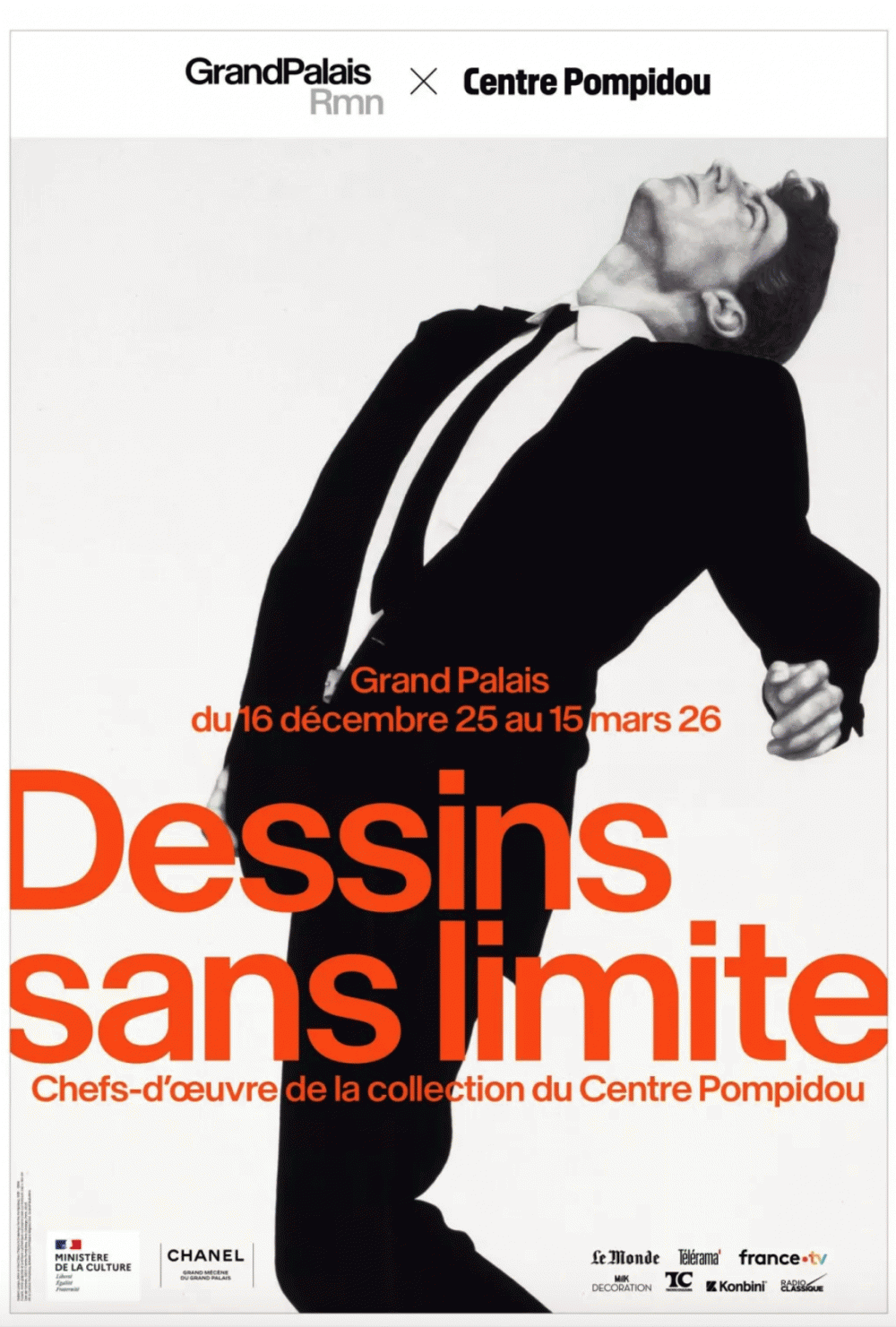
Mise en ligne 17 décembre
Dessins sans limite
Chefs-d’œuvre de la collection du Centre Pompidou
16 déc. 2025 - 15 mars 2026
Grand Palais, Paris
Avec plus de trente-cinq mille dessins, la collection du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou est l’une des plus importantes au monde. Pour la première fois, près de trois cents œuvres de cent-vingt artistes dont Dubuffet, Basquiat, Delaunay, Kentridge et bien d’autres révèlent, au Grand Palais, un art du dessin sans cesse réinventé.
De nombreux artistes se sont emparés de ce mode d’expression originel et cathartique pour transgresser les limites de l’art, faisant du dessin aujourd’hui un laboratoire de tous les possibles. Au-delà de la feuille ou du traditionnel carnet, son domaine s’étend à d’autres supports, jusqu’au mur ou à l’espace d’installation et s’ouvre à d’autres pratiques – photographiques, cinématographiques ou numériques.


Mise en ligne 15 janvier
"L'Art vu par la BD"
Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026
La Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec l’exposition L’Art vu par la BD.
Représentée à l’Académie au sein de la section gravure et dessin, la bande dessinée a rompu l’isolement qui fut autrefois le sien. Elle-même au carrefour de la littérature et des arts visuels, elle n’a de cesse, aujourd’hui, de se mesurer aux autres formes d’expression, documentant le parcours des plus grands artistes et interrogeant le mystère de la création. Tantôt informé, sérieux, biographique, son propos peut aussi être décalé, satirique, burlesque ou verser dans l’onirisme. Sous le crayon des dessinateurs, les arts se réinventent et quelquefois se mélangent : peinture, cinéma et comédie musicale fusionnent dans Moderne Olympia de Catherine Meurisse, membre de l’Académie ; l’architecture de la capitale Brasilia est célébrée par le prisme d’un film chez Jochen Gerner.
L’exposition réunit des exemples du regard que le 9e Art porte sur les disciplines représentées au sein de l’Académie : architecture, peinture, sculpture, photographie, musique, danse, cinéma, gravure et dessin. Les planches présentées pour l’occasion ressuscitent des figures aussi marquantes qu’Isadora Duncan, Alberto Giacometti, Henry Moore, Jacques-Louis David, Eadweard Muybridge, Maurice Ravel, Jacques Tati, Luchino Visconti ou Frank Lloyd Wright.
Commissariat de l’exposition : Thierry Groensteen


Mise en ligne 16 janvier
Impressions nabies
Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton
PROLONGATION > 8 mars
Si les artistes nabis, parmi lesquels Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis et Félix Vallotton sont largement connus pour leurs peintures et décors, ils excellèrent aussi dans l’art de l’estampe. Ce courant éphémère, qui se déploya pendant une dizaine d’années (1890-1900), donna lieu à une production abondante et diverse d’images imprimées mise en lumière dans une exposition présentée à la rentrée sur le site Richelieu.
Grâce aux ressources de la lithographie en couleurs et au renouveau de la gravure sur bois, les Nabis ont créé des œuvres variées, inscrites dans le quotidien : estampes artistiques, affiches, illustrations, programmes de spectacle, objets décoratifs.
Cet aspect de leur œuvre est dévoilé dans une exposition qui montre la diversité et la genèse de leurs créations graphiques à travers près de deux cents pièces provenant principalement des collections de la BnF, complétées par des prêts d’institutions françaises et étrangères (musée d’Orsay, musée Maurice Denis, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, musée des Beaux-arts de Quimper et musée Van Gogh d’Amsterdam).
L’exposition en bref
Les Nabis, promoteurs de l’art dans la vie, grâce à l’image imprimée
Le mouvement nabi dépasse le champ traditionnel des beaux-arts par une ouverture à tous les domaines de la création et en particulier aux arts décoratifs. Sa contribution diversifiée aux arts graphiques s’inscrit dans un désir d’intégrer l’art à la vie quotidienne et de le rendre accessible au plus grand nombre, comme l’affirme Bonnard : « Notre génération a toujours cherché les rapports de l’art avec la vie. À cette époque, j’avais personnellement l’idée d’une production populaire et d’application usuelle : gravure, éventails, meubles, paravents. » Sous l’impulsion d’éditeurs et de marchands novateurs, tel Ambroise Vollard, ces artistes ont œuvré à une période phare de l’histoire de l’estampe qui a consacré le peintre-graveur dans son statut d’artiste original. Certains ont exploré les ressources de la lithographie en couleurs (Maurice Denis, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Ker Xavier Roussel), tandis que d’autres ont contribué au renouveau de la gravure sur bois de fil (Félix Vallotton et Aristide Maillol). Grâce à ces procédés d’impression, ils ont créé aussi bien des estampes artistiques en feuilles ou en albums que des affiches, des illustrations pour des revues ou des livres de bibliophilie, des programmes de spectacle, des partitions de musique et des objets d’art décoratif (paravents, papiers peints, éventails…).


Mise en ligne 25 janvier
Mickalene Thomas
All About Love
17 décembre 2025 - 5 avril 2026
Le Grand Palais met à l’honneur l’artiste afro-américaine Mickalene Thomas avec All About Love : une rétrospective vibrante explorant la visibilité et la représentation des femmes noires et célébrant l’amour comme force de libération, d’affirmation de soi et de joie.
All About Love est une exposition monographique de l’artiste américaine Mickalene Thomas (1971, New York), reconnue à l’international pour sa pratique audacieuse et multidimensionnelle. Elle explore la représentation des femmes noires dans l’art, l’histoire et la culture populaire, en réinventant le portrait classique à travers une perspective queer et féministe noire.
La rétrospective couvre plus de deux décennies de création, mêlant peinture, collage, photographie, vidéo et installation. Au centre de son travail, l’amour apparaît comme une force de libération, de joie et d’affirmation de soi, thème inspiré par le livre fondateur de bell hooks, All About Love: New Visions (1999).
Les œuvres de Thomas rendent hommage à l’autonomie, à la beauté et à la résilience des femmes noires. Ses sujets - amis, famille, amants et icônes culturelles - sont représentés avec assurance, sensualité et grâce, et reconquièrent les espaces dont ils ont été historiquement exclus. Les compositions, souvent ornées de strass, invitent le public à entrer dans des mondes où le plaisir devient politique et la représentation radicale.
Thomas dialogue aussi avec l’histoire de l’art européen, en particulier français. Des œuvres emblématiques telles que Le Déjeuner sur l’herbe (1863) de Manet et La Grande Odalisque (1814) d’Ingres sont réinterprétées à travers un prisme contemporain, plaçant les femmes noires au centre du récit et transformant la lecture des classiques.
All About Love vous invite à découvrir un univers d’amour, de loisirs et de libération, où la beauté, l’intimité et la maîtrise de soi redéfinissent le regard historique sur l’art.
Après des expositions saluées au Broad (Los Angeles), à la Fondation Barnes (Philadelphie), à la Hayward Gallery (Londres) et aux Abattoirs (Toulouse), cette rétrospective constitue la plus ambitieuse présentation des œuvres de Mickalene Thomas à Paris.

Mise en ligne 18 janvier
Psyché, Vénus, Cupidon et les autres
Tous les samedis et dimanches du 10 janvier au 1e mars 16:00 - 17:00
sauf week-end des amoureux 14 et 15 février
La mythologie est peuplée de grandes figures. Les femmes, déesses, nymphes, magiciennes, y jouent un rôle prépondérant. Les artistes de la Renaissance n’hésitent pas à les représenter sur de nombreux supports. Partez à leur rencontre !
5€ en supplément du droit d’entrée


Mise en ligne 18 janvier
Illustrer l’histoire de France. L’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours
Du 25 janvier 2025 au 31 mai 2026
La salle d’exposition de Pierrefitte-sur-Seine - 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine
Qui n’a pas en mémoire l’image de l’un de ses anciens manuels d’histoire ? Reflets de leur temps, du développement des politiques scolaires et de l’évolution de la pédagogie au fil des siècles, ils contribuent à façonner une culture matérielle de l’école. Ces ouvrages sont aussi des objets autonomes, des vecteurs culturels qui témoignent des différentes conceptions de l’histoire nationale et de la longue querelle entre l’Église et l’État.
L’histoire à travers les manuels scolaires
Vercingétorix, Jeanne d’Arc, 1515… Loin du cliché d’une histoire de France éternelle campée sur ses frontières hexagonales, l’exposition Illustrer l’histoire de France s’intéresse à l’évolution de l’illustration des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours.
À travers une quarantaine de documents, elle raconte les enjeux forts de ce grand récit national depuis les origines. Elle débute par des portraits de rois et d’hommes illustres et aboutit à des ouvrages plus complexes, complétés puis concurrencées par le numérique.
L’objectif est de présenter au grand public la manière dont les manuels scolaires ont raconté l’histoire de France, mais aussi de décrypter les enjeux de ces représentations. Illustrer l’histoire de France incite à mesurer les effets pendant plus de trois siècles de ce panthéon scolaire sur la société contemporaine à travers les manuels que des générations d’élèves ont eus entre les mains. Les usages pédagogiques de ces livres témoignent de la transmission d’une certaine histoire qui s’apparente à « l’album de famille » de tous les Français.
Sont passées en revue les diverses interprétations, les instrumentalisations au service de la morale, de la religion et de la politique. Sans omettre les déformations dont les événements historiques ont pu faire l’objet, comme saint Louis sous son chêne ou Bernard Palissy brûlant ses meubles pour faire cuire ses céramiques.
Recréer l’ambiance d’une salle de classe
À l’entrée de la salle d’exposition, la mise en scène de manuels scolaires sur plus de trois siècles accueille le visiteur. Elle a été construite en résonance avec la grande frise chronologique « Archives et histoire » du parcours permanent, qui évoque les différents récits construits sur l’histoire de France. Elle met en avant des illustrations des manuels scolaires de la IIIe République, recontextualisées dans l’exposition Illustrer l’histoire de France.
L’atelier du musée des Archives nationales a conçu la scénographie autour d’une idée centrale : plonger le visiteur dans une salle de classe et ses transformations depuis le 18e siècle. Ainsi, le parcours présente une classe d’école avec son tableau noir, sa bibliothèque de fond de salle, ses tables en bois…
Visiter l’exposition s’apparente alors à une déambulation dans une salle de classe en même temps qu’à un voyage à travers le temps. Des images provenant de la collection du Musée national de l’éducation (Munaé) participent à cette immersion. Elles scandent l’espace en trois parties chronologiques.
Créer des récits avec les visiteurs
Quelles images de l’histoire de France avons-nous conservées dans notre mémoire depuis l’enseignement reçu à l’école ? La médiation de cette exposition propose aux visiteurs – adultes et enfants – de confronter leurs souvenirs des grands héros et des temps forts de cette histoire. Plusieurs classes de Saint-Denis vont ainsi questionner les manuels exposés.
Leur mission ? Réécrire des cartels descriptifs de quelques documents de l’exposition en associant récit personnel et analyse historique, puis les mettre en voix et en sons, avec l’aide de la journaliste productrice de podcasts, Iris Ouedraogo. Les visiteurs seront eux aussi invités à proposer leur cartel écrit pour présenter les images qu’ils choisiront.
YouTube est désactivé.
Autorisez le dépôt de cookies pour accéder à cette fonctionnalité.
Voir la vidéo de présentation
Trois périodes, quatre regards d'historiens.
Un comité scientifique coordonné par Thierry Claerr, responsable de la bibliothèque des Archives nationales, a conçu l'exposition en partenariat avec l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG). Organisée en trois parties chronologiques, l'exposition associe des historiens de chacune des périodes. Ainsi, Emmanuelle Chapron est intervenue sur la transmission de l'histoire dans la France d'Ancien Régime et à l'époque romantique (18e siècle-1848). De leur côté, Christian Amalvi et Jean-Charles Geslot se sont attachés à l'illustration du récit national de la révolution scolaire du 19e siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Joëlle Alazard a travaillé sur les nouvelles sensibilités scientifiques et pédagogiques, pour une transmission plus égalitaire et européenne, voire mondiale, de l'histoire de France.
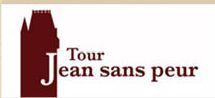

Mise en ligne 18 janvier
Succès !
Exposition prolongée jusqu’au 8 mars 2026
L’EXPOSITION
Contrairement aux idées reçues, les hommes et femmes du Moyen Âge se soucient de leur personne et de leur intérieur domestique.
À travers six thèmes (approvisionnement en eau, gestion des déchets, propreté corporelle, bains, latrines et médecine hygiéniste), cette exposition tente de mettre fin aux nombreux préjugés qui entourent cet aspect de la vie quotidienne au Moyen Âge.
Commissaire d’exposition :
Danièle Alexandre-Bidon (EHESS, Paris – CRAHAM, Caen)


Mise en ligne 25 janvier
MARTIN PARR
Global Warning
Du 30 janvier au 24 mai 2026
Jeu de Paume - Paris
Cette exposition propose de revisiter l’oeuvre de Martin Parr à l’aune du désordre généralisé de notre époque, à travers différentes séries réalisées depuis la fin des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Depuis cinquante ans, sans militantisme mais avec constance, aux quatre coins du globe, Martin Parr dresse un portrait saisissant des déséquilibres de la planète et des dérives de nos modes de vie.
« Je crée un divertissement, qui contient un message sérieux si l’on veut bien le lire, mais je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit – je montre simplement ce que les gens pensent déjà savoir », disait Martin Parr en 2021.
À travers ses nombreuses séries, commencées dans les îles britanniques et en Irlande, puis étendues dès les années 1990 aux cinq continents, émergent des thèmes récurrents : les turpitudes et les ravages du tourisme de masse, la domination de la voiture, les dépendances technologiques, la frénésie consumériste, ou encore notre rapport ambivalent au Vivant.
Toujours avec son regard singulier, et décalé Parr aborde indirectement plusieurs causes majeures identifiées des bouleversements climatiques de l’Anthropocène : usage effréné des transports, consommation d’énergies fossiles, surconsommation globale, dégâts environnementaux. Cet oeuvre, en apparence plaisant, se révèle, avec le temps et l’évolution des mentalités, peut-être plus grave qu’il n’y paraissait initialement. Avec le recul, son ironie mordante semble l’inscrire dans une certaine tradition satirique britannique : un humour incisif, une moquerie douceamère, au service d’un regard critique, indirect mais profond.
En quelque 180 oeuvres traversant plus de cinquante ans de production, de ses débuts en noir et blanc à des oeuvres récentes, l’exposition aborde, en 5 sections, nos turpitudes contemporaines, à travers des thèmes, des motifs, des obsessions récurrentes.


Mise en ligne 25 janvier
Leonora Carrington
Du 18 février 2026 au 19 juillet 2026
Artiste, féministe et écologiste d’avant-garde, femme, mère, migrante, touchée par la maladie mentale et chercheuse spirituelle en constante évolution, Leonora Carrington a laissé derrière elle un héritage aussi extraordinaire que radical.
Née en 1917 dans le Lancashire en Angleterre, Leonora Carrington s’est construite à travers le voyage, qu’il soit intérieur ou extérieur. De Florence à Paris, du Sud de la France à l’Espagne, jusqu’au Mexique où elle est devenue une figure culte, son parcours hors du commun a nourri une œuvre à la croisée du surréalisme, de la mythologie et de l’ésotérisme.
Cette exposition est la première consacrée uniquement à son œuvre en Italie et en France et présente Carrington comme une "Femme de Vitruve" : une artiste totale, représentant un modèle en terme d’harmonie et d’innovation. Ses créations fusionnent humain et animal, masculin et féminin, donnant forme à un monde où métamorphoses et symboles se répondent.
À travers une approche chronologique et thématique, ainsi qu’une présentation inédite de ses créations visionnaires diverses, le parcours explore les thèmes et centres d'intérêts principaux de l’artiste : découverte de l’art classique italien à Florence durant l’ adolescence, fascination pour la Renaissance, origines celtiques et post-victoriennes, ou encore participation au surréalisme pendant son séjour en France.
L’exposition met ainsi en lumière l’héritage exceptionnel de cette voyageuse perpétuelle, toujours en quête de connaissance d'elle-même.


Mise en ligne 25 janvier
Clair-obscur
4 mars > 31 août
À l'appui d'une vingtaine d'artistes modernes et contemporains de la Collection Pinault, l'exposition « Clair-obscur » traverse, de l'obscurité à la lumière, l'héritage du chiaroscuro qui résonne avec le temps présent. Le musée se métamorphose en un paysage à la fois luministe et crépusculaire, et immerge le visiteur dans une réflexion entre visible et invisible, où s’expriment la matérialité de la lumière et les zones d’ombre de l’inconscient.
« Le contemporain est celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l’obscurité. Tous les temps sont obscurs pour ceux qui en éprouvent la contemporanéité. Le contemporain est donc celui qui sait voir cette obscurité, qui est en mesure d’écrire en trempant la plume dans les ténèbres du présent ».
Mais que signifie « voir les ténèbres », « percevoir l’obscurité », s’interroge le philosophe italien Giorgio Agamben ? À la Bourse de Commerce, l’exposition « Clair-obscur » explore cette réflexion à partir d’œuvres d’artistes de la Collection Pinault qui, de l’art moderne à aujourd’hui, se sont détournés des scintillements factices du monde pour en sonder les zones d’ombre qui se conjuguent parfois aux éclats de lumière et viennent ainsi éclairer le temps présent.
Le musée se métamorphose en un paysage luministe et crépusculaire, où les œuvres souvent immersives se dévoilent dans un jeu d’ombres et de lumières. « Clair-obscur » emprunte ainsi son titre aux contrastes du fameux chiaroscuro, qui s’invite dans la peinture depuis le 16e siècle, dans le maniérisme et l’âge baroque, à l’image de l’œuvre du Caravage qui en intensifie l’usage, plongeant le monde terrestre dans l’obscurité, alors que des rayons de lumière accentuent la tension dramatique et les enjeux spirituels sous-jacents à l’œuvre. Son influence se fait sentir dans l’œuvre de Victor Man dont un ensemble d’œuvres sera présenté et la poétique de Bill Viola, dont deux pièces majeures appartenant à la Collection Pinault seront exposées, qui s’inspire des maîtres anciens pour faire advenir des corps émergeant de l’ombre dans une temporalité ralentie.
Dans l’exposition, la peinture et l’art tout entier n’auront alors de cesse de conjuguer l’ombre et la lumière. Le clair-obscur n’est donc pas seulement une technique picturale du passé: il est un langage visuel qui traverse les siècles et se renouvelle sans cesse, révélant toute la part d’obscurité de l’homme et du monde. Il donne sa tonalité à tout un pan de la création, un ressort narratif, un principe philosophique. Il exprime à la fois la matérialité de la lumière et les zones d’ombre de l’inconscient, transformant notre rapport au visible et à l’invisible. Dans la Rotonde, sous le dôme zénithal du musée, le chef-d’œuvre de Pierre Huyghe, Camata (2024), s’ancre, après sa présentation dans l’exposition « Liminal » à la Punta della Dogana à Venise, dans cette scène circulaire qui se meut alors en amphithéâtre hors du temps. Ici se déploie le rituel métaphysique filmé par l’artiste dans l’immensité du désert d’Atacama au Chili.
En parallèle, les vingt-quatre vitrines du Passage de la Bourse de Commerce, accueillent une carte blanche à Laura Lamiel qui expose un corpus d’œuvres spécifiquement imaginées pour cette présentation. Ses installations où la couleur et la lumière jouent un rôle essentiel, s’inspirent autant de la psychanalyse que de la cosmologie spirituelle et s’appuient sur un répertoire de formes sensibles constituées d’objets trouvés, de collections et de certaines taxonomies de matériaux qui contrastent avec les surfaces immaculées de l’acier qu’elle éclaire avec des tubes fluorescents.
Commissariat: Emma Lavigne, directrice et conservatrice générale de la Collection Pinault


